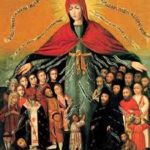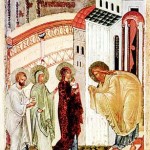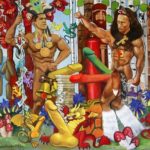1895 MIKHAÏL YOURIEV (Mikhaïl Abramovitch Morozov)
1895
MIKHAÏL YOURIEV (Mikhaïl Abramovitch Morozov)
<Réflexions sur deux expositions des Ambulants à Moscou>[1]
[Il y a à Moscou 2 expositions, une des Pétersbourgeois, une autre des Moscovites]
“Il est difficile d’imaginer des expositions plus différentes.
Chez les ‘Pétersbourgeois’ tout est propre et décent : les salles spacieuses du Musée Historique, un catalogue – petit livre sur papier fin, des tiroirs pour conserver les cadres, des panneaux décoratifs, des couleurs tranquilles, des figures dans des poses figées, des sujets clairs, connus de tous.
Chez les ‘Moscovites’ tout est fougueux et…assez inepte : pour aller d’une première salle dans la deuxième, il faut passer par un escalier glacial, le catalogue, bien qu’il soit édité en carton avec une vignette du peintre Simov, se distingue par des négligences étonnantes [Suit une énumération de noms d’artistes dont l’orthographe n’est pas respectée]. Les cadres de quelques tableaux sont en bois, les couleurs sont si barbares que je refuse carrément de les comprendre (par exemple, une étude des boulevards parisiens de K.A. Korovine); les sujets sont tout simplement incompréhensibles (Veuillez deviner le sujet du tableau de Mr Malioutine Curiosité)…
D’ailleurs ces expositions ont un caractère commun : l’inculture des oeuvres qui y sont montrées. En effet, la majorité des tableaux exposés pèchent contre les règles les plus élémentaires de la perspective aérienne et linéaire, de l’anatomie etc.”. (p. 179-180)
“J’aime deux tableaux de Konstantine Alexéïévitch Korovine, Étude et Idylle septentrionale (Je refuse catégoriquement de comprendre Les boulevards parisiens de cet artiste). Je me souviens depuis déjà longtemps des tableaux de Korovine et il est toujours resté pour moi une énigme. Il possède la sensibilité des tons et du coloris, mais il est totalement privé de toute compréhension du dessin : il ne le ‘sent’ pas. Et alors, au lieu d’apprendre à bien dessiner, il néglige totalement le dessin et peint largement, en coups de pinceaux, sans du tout comprendre que l’on ne peut seulement peindre ainsi que si l’on connaît le dessin jusqu’à la virtuosité.
Un chef d’orchestre expérimenté peut retarder le tempo, mais l’élève ne peut pas le faire s’il ne sent pas du tout la mesure. Et, comme élève, M. Korovine, est tantôt terriblement timide (par exemple, dans les coups de pinceau, tantôt incroyablement audacieux (par exemple, dans la robe et les cheveux de la figure féminine de cette même Étude). Quand il est audacieux, ses coups de pinceau sautent en faisant des zigzags et des virgules. M. Korovine, à ce qu’il me semble, ne comprend pas du tout que les coups de pinceau doivent avoir un caractère précis, selon qu’ils représentent : une robe, un visage, de la soie ou de la laine. Par exemple, si l’artiste veut peindre une robe, ses coups de pinceau doivent rendre le caractère des plis que prend le tissu. Mais où donc peut comprendre cela un homme qui ne sent pas du tout le dessin ! Mais, malgré tout, les tableaux de Konstantine Korovine me plaisent. Son Étude est peinte dans un ton chaud plaisant, légèrement marron. L’Idylle septentrionale éclate du rapport extrêmement joli d’un vert mat avec les robes rouges des paysannes. Mais le sujet de l’Idylle est totalement absurde (un berger est couché sur l’herbe et devant lui se tiennent des figures féminines mal dessinées) et il y a là vraiment trop d’imitation des Français contemporains”. (p. 188-189)
“Nous vivons une époque très intéressante. La foule grise, ordinaire, a relevé la tête et s’est mise à déclarer ses exigences et désirs. Cela s’est manifesté en tout : dans la littérature, le théâtre, la science et la peinture. En particulier dans la peinture. Il n’y a là, bien entendu, rien de mal. Mais c’est que la foule russe est extrêmement non cultivée et peu développée précisément du côté artistique. Nous n’avons pas, par exemple, chez nous à Moscou de tableaux de maîtres anciens, beaucoup de galeries d’art sont peu accessibles, il n’y a pas à la vente d’éditions d’art bon marché. En outre, la foule a commencé à vivre depuis peu : maintenant personne ne reçoit l’éducation artistique qui était donnée dans les vieilles familles nobles. D’où alors, en vérité, peut-on acquérir une éducation artistique? Et en même temps, je le répète, la foule est devenue aujourd’hui une dirigeante sur le marché de l’art : on peint beaucoup de tableaux, mais les véritables connaisseurs achètent si peu que chacun qui a cent roubles de trop est déjà un acheteur, pose ses exigences, critique, choisit. Et d’ailleurs ces petits acheteurs à cent roubles sont des milliers, des dizaines de milliers et on comprend que MM. les artistes penchent de leur côté et se mettent à faire la marchandise pour laquelle il y a de la demande”. (p. 191-192)
[Analysant le tableau du peintre Liev Lagorio La bonace, Mikhaïl Abramovitch Morozov écrit] :
“Y sont représentés deux dauphins suspendus en l’air. L’artiste voulait visiblement représenter le saut. La question est : est-ce que la peinture peut ou non représenter le mouvement ? C’est une question ancienne. Maintenant, comme je l’ai déjà mentionné, la mode est à la mode prétendue tendance individualiste en art, l’aspiration à rendre son impression individuelle a commencé à prévaloir. C’est pourquoi on représente, par exemple, une roue en rotation, non avec ses rayons, mais sans eux, parce que l’oeil de l’homme, lors de la rotation d’une roue, ne distingue jamais ses rayons. Du point de vue de l’impressionnalisme [sic!] un dauphin, suspendu en l’air est une absurdité parce que l’on ne peut le voir dans cette pose. Du point de vue de la théorie de l’art, c’est aussi une sottise parce que déjà le vieux Lessing disait que représenter le mouvement (en l’occurrence – un saut) n’est pas dans les forces de la peinture. Ce dauphin suspendu dans l’air, c’est simplement le résultat de la volonté de complaire aux goûts du public”. (p. 194-195)
“Le temps est passé à présent pour la tendance petite-bourgeoise engagée. On en a assez des vieux thèmes, mais rien ne surnage de nouveau à la surface de la vie et comme résultat – une terrible pauvreté de contenu dans les tableaux présentés à la XXIIe exposition ambulante. Et grâce à cette absence de thèmes les défauts techniques deviennent encore plus évidents – un coloris terne, un dessin incorrect, une ignorance de l’anatomie et même du mauvais goût quasi involontaire de beaucoup des oeuvres exposées.
À dire vrai, la peinture russe, ces dernières années, a baissé du point de vue technique. L’Académie, Rome, la copie des classiques, le mécénat éclairé de la noblesse, en un mot tout ce que, selon Vassili Stassov, on était habitué de considérer comme un ‘frein’ de l’art russe, maintenait à une hauteur européenne la peinture russe. Le Serpent d’airain de Bruni, Le Dernier jour de Pompéi de Brioullov, tout cela, c’étaient de leur temps des oeuvres européennes. Et maintenant. quand dans son histoire des art, parue il y a deux ans, Richard Muther dit que l’art russe ne participe pas encore au courant artistique européen et appelle la peinture russe ‘une âme morte’, – que peut-on vraiment dire, que peut-on répliquer ?”. (p. 197-198)
“L’influence française est visible sur le tableau de Korovine Carmencita. Il est peint dans des tons marron très agréables et peints pas mal du tout. Une Espagnole est représentée, maigre, avec des traits aigus, sans buste – tout cela est très juste et caractéristique d’une Espagnole. Le vin d’une couleur dense jaune a aussi beaucoup de style. Pour tout dire, c’est une chose fort aimable. L’influence de Paris qui se fait sentir dans les derniers travaux de Korovine a donné en l’occurrence des résultats bénéfiques”. (p. 202)
“Il faut imiter les Français avec beaucoup de précaution : la vie artistique est si vigoureuse et abrupte là-bas que, on le comprend, elle rejette à la surface beaucoup de choses laides et maladives”. (p. 204)
“La vieille école se divisait en deux courants : celui de Savrassov et de Vassiliev (états d’âmes et poésie), et celui de Chichkine (vérité et exactitude du rendu de la nature, je voudrais dire ‘géographique’). Maintenant la peinture paysagiste russe a pris une autre direction. C’est celle de l’impressionnalisme [sic!], dans un sens beaucoup plus large que ce mot est compris habituellement : l’artiste vis à rendre son impression, sans se soucier le moins du monde de savoir si les autres partagent ou non cette impression. Si une chose quelconque produit une impression sur l’artiste, il représente seulement cette chose sans se préoccuper d’autre chose. Je le répète, les années 1890 de notre siècle sont marquées partout par la manifestation éclatante et tranchée des goûts personnels, des besoins personnels. Cette nouvelle tendance dans la peinture est encore très jeune et se signale encore par beaucoup de défauts techniques même si, malgré tout, quelque chose de frais et de talentueux perce par moments. Il faut reconnaître que presque tous les tableaux sont analphabètes du point de vue européen : le caractère du feuillage n’est pas rendu dans les arbres, le premier plan n’est pas lié au fond etc. Mais je ne vais pas parler de cela : je vais noter ce qui est bien et indiquer seulement les défauts vraiment impardonnables”. (p. 212-213)
[Mikhaïl Morozov trouve les oeuvres de Viktor Vasnetsov bonnes :], “surtout son Lointain est intéressant : il y a une foule de défauts, le tableau n’est presque pas terminé, mais malgré tout, quelle oeuvre jolie et charmante, comme on sent en elle l’amour de la nature. La Colline de Péroune à Kiev est aussi bonne, quel ciel intéressant et comme le lointain est peint pitoyablement et négligemment ! D’ailleurs la négligence est le propre de presque tous les paysages des artistes russe. Mr Sérov, dans son paysage En Crimée a présenté dans le lointain un boeuf si noir qu’il ne saurait l’être à proximité. Dans Sur le lac de Lévitane, les arbres sont tout à fait enfantins, la laiche est faite avec un seul ton et d’égale grandeur devant et plus loin, c’est pourquoi la surface de l’eau ne s’éloigne pas du tout; dans Les ombres du soir, le premier plan est plus faible que le plus lointain. D’ailleurs je n’insiste pas particulièrement sur les défauts : ces deux tableaux sont totalement insignifiants quant à leur contenu. En revanche, dans le tableau Au-dessus du repos éternel il y a des contenus pour deux tableaux; à cause de cela le tableau ne produit pas d’impression harmonieuse et stricte. Il est exécuté très malencontreusement : la terre paraît être découpée et collée sur l’eau, la nuée n’a pas son reflet dans la rivière. L’étude de Lévitane Venise n’est pas mal du tout : dans l’eau il y a de l’humidité et du mouvement”. (p. 214-215)
“Chez nous, l’artiste est hébété à force de coups et harassé : l’absence de sécurité matérielle des artistes, le bas niveau de l’éducation se font sentir en tout. Maintenant à Moscou, par exemple, se tient un Congrès d’artistes et presque personne parmi les artistes n’y intervient.
Oui, parmi les artistes russes il y a peu de personnes cultivées! Et donc où pourraient-ils peindre, par exemple, des tableaux historiques?”. (p. 220)
“Quelqu’un a dit qu’au bout de trente-trois ans une génération remplace une autre : à présent est arrivé le moment de cette rupture. On voit cela particulièrement en Europe occidentale : vous savez certainement combien ont changé Berlin, Paris, Rome pendant ces trois-quatre dernières années. Ce changement se produit aussi chez nous, – bien entendu avec des inflexions originales. Nous restons encore en retard dans beaucoup de choses et beaucoup de choses ont disparu chez nous, sans avoir réussi à s’épanouir comme il l’aurait fallu et, entre parenthèses, de profondes racines ont pris pied comme en Occident. Je pense toujours, par exemple, à l’avenir de notre bourgeoisie.
Qu’on le veuille ou non, il faut reconnaître que la bourgeoisie est une force chez nous à Moscou. Et elle applaudit aux premières des pièces de théâtre et elle achète des tableaux et elle parle de politique. Auparavant, elle avait peur du commissaire de police, elle appelait une bouteille ‘un flaconnet’, au lieu de ‘sers-moi’ elle disait – ‘verse’ et elle mettait la lettre ‘iat’[2] là où elle ne devait pas être. Maintenant on parle grosso modo correctement, même si on utilise des expressions du genre ‘j’étais dans la fatigue’ et on a un diplôme universitaire. Maintenant la bourgeoisie ne craint personne, seulement que la princesse Sourded’oreille ne l’invite à un bal et que ne vienne lors d’un dîner d’invitation un aide de camp connu [p. 238] Avant, la bourgeoisie considérait le champagne comme la boisson suprême, maintenant c’est le Mouton Rothschild 1868. Avant, les femmes étaient soumises, maintenant elles flirtent éperdument. Avant, dans les magasins d’un bazar se faisaient des transactions sur la seule parole que personne ne se serait aventuré de violer, ne serait-ce que parce que cela menaçait de ruine, et maintenant, la parole des marchands a perdu sa valeur. Tout doit être écrit et obligatoirement à l’encre, comme cela est exigé par la loi.
Lors du dîner des membres du premier Congrès artistique, les Rousskiyé viédomosti [Les Nouvelles russes], N° 115 de 1894, N.V. Bassine a déclaré que ‘Nikolaï Serguéïévitch Trétiakov[3] a mérité d’être remercié, ne serait-ce que parce qu’il a reconnu valides les plus-values portées au crayon, des sommes qui lui ont été léguées par son père. Et qu’est-ce qu’il en serait si la volonté du défunt avait été exprimée oralement ? Nikolaï Serguéïévitch Trétiakov l’aurait bien entendu exécutée, mais n’est-il pas vrai qu’alors on l’aurait considéré comme un héros. Comme sont brouillées maintenant les conceptions morales fondamentales ! Je vous assure, c’était mieux dans l’ancien temps ! Mais les pères ont terminé leur carrière et maintenant la place appartient aux fils. Parfois les fils disent beaucoup de choses, mais chez nous, à Moscou, dans la classe des marchands, les fils [p. 239] sont pires que leurs pères. ‘Les pères’ qu’a représentés Ostrovski portaient de longues barbes, mais ils comprenaient malgré tout qu’il y avait des professions plus hautes que le courtage ‘du coton et du thé’, que le bonheur consistait non seulement en ce que la fabrique apportât des dividendes de trois millions et que Khristofor du ‘Strielna’[4] s’incline jusqu’à la ceinture, tandis que les tsiganes chantent, cela va de soi, à leur santé.
Dans une revue des années 1870 était énoncée une idée, à première vue très juste : quelqu’un s’était plein de la décadence de la littérature- ‘Attendez’, disait la revue, ‘nous aurons encore des Pouchkine et des Lermontov et apparaîtront de jeunes Tolstoï et Tourguéniev. Maintenant ce sont les roturiers qui écrivent : ils ne pouvaient recevoir une éducation dans les endroits où elle était pour les écrivains-nobles. Mais notre bourgeoisie croît, donne de l’éducation à ses enfants et si apparaissent parmi ces enfants des personnes de talent, alors ils déploieront leurs aptitudes naturelles, l’accalmie passagère dans la littérature disparaîtra et sa période d’or (plus exactement, d’argent) arrivera.
Cette pensée a été dite souvent et maintenant elle est exprimée également. Dans le numéro d’avril de Artist [L’Artiste], M. Baltanov dit, à propos des oeuvres d’Ostrovski écrites après la réforme[5] [p. 240] : dans le milieu des marchands qui se tiennent proches de la masse populaire sont nés des aspirations à l’éducation, le sens de l’égalité et de la dignité personnelle et avec elle est stimulée l’énergie dans la défense de ses droits. Le tableau donne l’impression des premiers journées printanières qui suivent un long hiver rigoureux : la pression des eaux printanières a fait déjà se casser la glace de la rivière, de dessous la neige perce par ci par là une tendre herbette verte. Ostrovski aimait ces choses là il y a environ quinze ans – mais maintenant, semble-t-il, il est temps que ce soit l’été, alors que, entre parenthèses, nous avons un automne jaune pleureur. Il est vrai que l’éducation a pénétré dans la bourgeoisie, les jeunes gens de la classe marchande ont beaucoup de connaissances (à l’exclusion de la familiarité avec les littératures et les langues étrangères : M. Boborykine, en représentant son Koumatchov[6] parlant bien l’anglais et le français, a fait une grande erreur sur les moeurs et les usages).
Mais que donne donc notre bourgeoisie sur n’importe quel domaine intellectuel ? Je puis m’accommoder du fait que Pouchkine ait grandi sur les redevances de la taille dans le gouvernement de Pskov, mais qu’est-ce qui m’accommodera avec les divers aspects sombres, admis par tous, admis par tous, de l’ordre capitaliste ? [p. 241] Je ne parle pas de la seule littérature, bien qu’en elle se reflètent la vie et l’état d’esprit de la société. Le noble, bien qu’il prît la taille et profitât de la corvée, était reconnu malgré tout comme une part de ce tout énorme qui a nom Russie. Absorbant l’argent qu’il en tirait, il était malgré tout utile à l’État, ne serait-ce que parce que, en servant, il était toujours prêt à perdre sa vie pour elle. Mais cela paraissait insuffisant à beaucoup et ces nobles en souffraient et se repentaient : la ligne des nobles repentants commence chez nous avec Radichtchev.
Parmi les partisans de la bourgeoisie contemporaine, il semble que l’on ne voit pas de repentants. Au contraire, ils trouvent qu’il leur est encore peu donné : quand ils ont la possibilité de parler, ils ne parlent que de leur propre profit, de leur propre intérêt. À l’automne de l’année passée a résonné le discours du président du comité de la foire, Savva Timofiéïévitch Morozov. Il parlait devant le ministre, devant la Russie et que demandait-il ? Que l’on fasse attention et favorise – sans doute pensez-vous – l’industrie ? Non, seulement sa branche cotonnière. Comme cela est mesquin et étriqué. Il n’y aura jamais d’homme d’État issu du milieu de la bourgeoisie moscovite, il n’y aura jamais de ministre ! [p. 242] Et, je le répète, ce sont tous des ‘fils’ qui ont été dans les universités et ont voyagé à l’étranger”.
“Se procurer de l’argent d’où qu’il vienne – voilà la seule chose bonne et respectable et cela ne vaut pas la peine de dire quel était cet argent : l’argent n’a aucune odeur. Et en ayant de l’argent on peut tout faire : construire des maisons avec trois mille ampoules électriques, offrir aux femmes entretenue des diamants de la taille d’une noix, avoir comme connaissances cinq descendants de Riourik[7], dépasser tout le monde sur sa paire de chevaux moreaux dans le Parc Pétrovski et remplir sa salle à manger de l’odeur épicée, spécifique des mets de prix, de cette odeur qui irrite M. Boborykine à un point tel qu’il nous en parle à plusieurs reprises dans son nouveau roman”. (p. 244-245)
[1] Extraits de la seconde partie du livre de Mikhaïl Youriev (Mikhaïl Morozov), Moï pis’ma (4-vo dékabriya 1893-15 mai 1894) [Mes Lettres (4 décembre 1893-15 mai 1894)], Moscou, Grossman et Knebel, 1895
[2]14 Le “iat'” est une ancienne lettre de l’alphabet cyrillique; elle n’est plus utilisée que dans la langue d’église. Elle fut supprimée de l’alphabet cyrillique russe lors de la réforme orthographique de 1918, au prétexte d’un double emploi avec la lettre е (« ié »).
[3] Nikolaï Serguéïévitch Trétiakov (1857-1896), peintre, fils de Sergueï Mikhaïlovitch Trétiakov, collectionneur, neveu du fondateur de la Galerie Trétiakov, Paviel Mikhaïlovitch Trétiakov.
[4] Khristofor était le chef d’un choeur tsigane dans le restaurant “Strielna” à Moscou.
[5] Il s’agit de la “Réforme paysanne” du tsar Alexandre II qui a aboli le servage en 1861.
[6] Il s’agit du personnage d’un marchand dans le roman de Boborykine Péréval [Le passage] (1894)
[7] Prince varègue de la Rous’ de Kiev au IXe siècle, fondateur de la première dynastie russienne régnante.