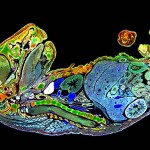La nature comme philosophie du kaléidoscope chez Malévitch
Jean-Claude Marcadé
La nature comme philosophie du kaléidoscope
“Sie, die kein Meister allein, die wunderbar
Allgegenwärtig erzieht in leichtem Umfangen
Die mächtige, die göttlich schöne Natur.”[1]
“Dans le kaléidoscope, un tas de choses sages.Vous remuez et cela donne une figure sage ou folle, ou bien un tas de folies. Vous remuez et vous avez une image folle ou sage.”[2]
“Le miracle de la nature est dans le fait qu’elle est tout entière dans une petite graine et cependant on ne peut embrasser tout cela.”[3]
Il est un malentendu constatant dans l’histoire de la pensée occidentale, et tout particulièrement dans l’art de peindre, c’est celui qui touche au concept de “nature”. La nature est toujours considérée comme quelque chose de distinct, d’isolé, en face de quoi, à la face de quoi l’homme s’harmonise ou se désaccorde. La nature, pour le peintre, ce fut ce qui apparaît aux yeux et qui est reproduit le plus fidèlement possible par le dessin et la couleur. Du moins, c’est ainsi que l’esthétique, dans sa prétention à établir des cadres et des catégories, le traduisit. Dans la réalité, ce fut, bien entendu, le pictural qui triompha et non le mimétisme grâce auquel les accidents du monde furent enregistrés. Et ainsi, la nature fut saisie par le pictural dans son coeur même, comme le site où reposent la croissance, la venue, l’épanouissement du monde, un des sites privilégiés de l’être, la source d’où émane toute forme-idée. Cela, faut-il le répéter, fut toujours le fait du pictural depuis qu’il se manifeste. Et, au vingtième siècle, cela a été porté à l’expression cruciale, maximale, suprême, par Malévitch dans son oeuvre picturale, philosophique, théorique.
La nature est le site essentiel de toute l’oeuvre de Malévitch. La Nature de Malévitch, à travers les malhabiletés des tableaux impressionnistes, puis symbolistes, triomphera, sous l’influence de la peinture d’icônes et du loubok, dans un néo-primitivisme puissant qui, associé au cubofuturisme, donnera le cycle le plus vigoureux du XXe siècle ayant pour thème la campagne. L’approfondissement de la nature sera donné ensuite dans le suprématisme. Comme dans la philosophie grecque la plus ancienne, la nature apparaît comme φύσις, comme lieu de croissance, d’épanouissement, de venue au jour. Selon Heidegger, “La physis est l’être même, grâce auquel seulement l’étant devient observable et reste observable.”[4]
Le rapport entre le pictural et la nature est inscrit dans le vocabulaire russe, puisque le même mot tsviet désigne à la fois la couleur (comme propriété d’un corps) et la fleur, la floraison; d’autre part, le mot, presque identique graphiquement et phonétiquement sviet désigne à la fois le monde et la lumière.
Quand Malévitch écrit à Matiouchine en décembre 1915 que le suprématisme “désigne la domination”, il s’agit de la domination de la nature en tant qu’être pictural par excellence. On se souvient du beau passage consacré à Claude Monet dans Des Nouveaux systèmes dans l’art (Vitebsk, 1919) :
Si, pour Claude Monet, les plantes picturales sur les murs de la cathédrale étaient indispensables, le corps de la cathédrale, il le considérait comme les plates-bandes d’une surface plane, sur lesquelles poussait la peinture qui lui était nécessaire, comme le champ et les plates-bandes sur lesquels poussent des herbes et des semis de seigle. Nous disons comme le seigle est magnifique, comme les herbes des champs sont belles, mais nous ne parlons pas de la terre. C’est de cette manière que nous devons examiner ce qui est pictural et non pas le samovar, la cathédrale, la citrouille, la Joconde[5].
Cette référence à la croissance est plus qu’une métaphore biologique, c’est une affirmation que la couleur, qui est “la propriété qu’à un corps de provoquer la sensation visuelle d’une composition spectrale”, que cette couleur (tsviet) est le terrain (ou le terreau) de l’être qui fait pousser et germer le pictural dans le monde. Les surfaces planes suprématistes sont “les germes de l’espace saturé de couleur”.
Le jeune Kazik a été imprégné de la nature pendant son enfance et son adolescence en Ukraine. Jusqu’à l’âge de 17 ans, au moment où il part pour la ville de Koursk pour travailler comme dessinateur technique aux Chemins de fer, il vit au gré des déplacements de son père qui était contremaître dans des usines de sucre de betterave dans des endroits perdus de la campagne ukrainienne : “C’est au milieu de ces villages, dispersés dans des petits coins de nature, agréables éléments de paysage, que se déroule mon enfance[6].” C’est là que le jeune garçon a eu ses premières émotions artistiques. C’est en premier lieu la nature qui l’imprègne jusqu’à ses 12 ans. L’art n’a alors aucune existence pour lui. Même les icônes qui étaient dans la maison familiale ne lui disent rien[7]. Il observe les cigognes, les éperviers qui s’envolent dans les hauteurs.
J’aimais regarder ces champs le matin quand le soleil n’est pas encore haut, que les alouettes s’élèvent dans les airs tout en chantant, que les cigognes volent à la recherche de grenouilles en claquetant et que les milans guettent, en tournoyant dans les hauteurs, les oiseaux et les souris[8].
Voici ce qu’il rapporte dans ses mémoires de 1918:
Je me souviens et n’oublierai jamais que j’ai toujours été frappé au premier chef par la coloration, la couleur, puis par les tempêtes, les orages, les éclairs et, en même temps, par le calme complet après l’orage. L’alternance du jour et de la nuit me troublait beaucoup, et je me souviens aussi comment l’on avait du mal à me faire coucher ou à m’arracher à l’entraînement qui me poussait à observer ou plutôt à simplement regarder les étoiles qui brillaient dans l’espace céleste, sombre comme les freux .J’aime également les rayons de lune dans la chambre, avec les fenêtres reflétées sur le sol, dans le lit, sur les murs, et bien que nombre d’années se soient écoulées, ces phénomènes sont restés gravés en moi jusqu’à maintenant[9].
Plus loin, il insiste sur cette imprégnation quasi ontologique de la nature sur tout son être physique et mental: les flaques après l’averse, les lambeaux de nuage, le reflet du soleil sur l’eau dans les champs et sur les lacs, et d’ajouter:
J’aimais marcher et m’enfuir dans les forêts et les hautes collines d’où l’on pouvait voir l’horizon tout autour et cela est resté jusqu’à maintenant [il a 39 ans quand il écrit cela]. Et l’on peut aussi déduire que la culture humaine dans son entier n’a eu aucune influence sur moi, seules agirent les créations de la nature[10].
Pratiquement, tous les textes de Malévitch font référence explicite à la nature. À ce propos, on doit noter qu’il emploie tantôt le mot priroda, tantôt le mot d’origine latine natoura. Il semble que le peintre distingue parfois la natoura, comme la nature extérieure, quelque chose comme la natura naturata, et la priroda comme la natura naturans.[11] Ainsi, dans son traité de 1916, Du Cubisme et du futurisme. Le nouveau réalisme pictural, il écrit : “Répétant ou calquant les formes de la nature (natoura), nous avons éduqué notre conscience dans une compréhension erronée de l’art[12]“.Et plus loin, il déclare :
La nature (priroda) est un tableau vivant et on peut l’admirer. Nous sommes le coeur vivant de la nature. Nous sommes la construction la plus précieuse de ce tableau vivant gigantesque.
Nous sommes son cerveau vivant qui agrandit la vie[13].
Plus loin encore :
Le carré est un enfant royal plein de vie.
C’est le premier pas de la création pure en art. Avant elle, il y avait des laideurs naïves et des copies de la nature (natoura)[14].
La “nature” c’est aussi, dans la pratique de la peinture et de la sculpture des académies, un objet réel qu’on se propose de représenter. L’ami d’enfance, le compositeur ukrainien Nikolaï Roslavets écrit en 1917, dans son article “O “bespredmietnom“ iskousstvié” [De l’art “sans-objet”] pour l’almanach Supremus, non publié pour cause de révolution:
La notion de “sans-objet” peut être ramenée à la simple négation de la dépendance de l’artiste de la nécessité de représenter l’objet, de la soumission aux canons, exigeant qu’il copie la “nature“ [natoura], de la reproduction autant que possible exacte de la nature (priroda) visible des objets qui nous entourent[15].
Cependant, dans de nombreux cas, cette distinction n’est pas aussi tranchée et le mot priroda a souvent le sens de la nature visible et de la nature en soi. Je donnerai deux exemples. Dans un passage d’un article du journal Anarkhiya en 1918, le peintre affirme :”Malgré l’énorme maîtrise, malgré le rendu parfait de la nature, [les maîtres de la Renaissance] ont atteint seulement la moitié de l’idée qu’avait posée le sauvage: voir le tableau comme un miroir de la nature[16].” Ici, c’est le mot priroda qui peut signifier les deux aspects de la nature. Et dans un autre article d’Anarkhiya, il précise ce qu’il entend par le mot priroda :
La nature est un tableau vivant, on peut l’admirer. Nous sommes le coeur de la nature, la construction précieuse de la gigantesque Terre vivante et des étoiles et, dans le même temps, nous profanons, nous mettons à mort sur les toiles des morceaux de nature, car n’est-il pas vrai que tout tableau peint à partir du vivant est une poupée morte[17].
La même ambigüité de l’emploi de natoura et de priroda se retrouve dans un article paru en 1928 en ukrainien dans la revue Nova guénératsiya, “Analyse du nouvel art représentateur. Paul Cézanne”. Il s’agit d’une traduction d’un texte russe dont nous n’avons pas l’original. Ce n’est pas Malévitch le traducteur. Confrontant le dessin d’album Tête d’adolescent de Répine (1884) au Joueur de cartes de Picasso (1914, MoMA), le peintre écrit :
Cette confrontation a pu nous donner l’impression que les nouveaux arts venaient d’une autre planète qui n’avait rien de commun avec nos lois terrestres et la perception humaine ainsi qu’avec la structure (boudova) physique de l’oeil du peintre. Mais, en réalité, il n’en est pas ainsi. Le lien du nouvel art et de l’art représentateur avec la nature (natoura) de notre nature profonde (priroda) [iz natouroï nachoï prirody] est le même, mais il a progressivement changé, en se différenciant, de façon très insignifiante et à peine sensible, d’oeuvre en oeuvre[18].
Ce qui est clair, en tout cas, c’est le reproche fait aux “spécialistes de l’art” et aux jugements de la critique: “À cause de leur analyse académique purement visuelle-optique de l’identité de la nature, [ils] n’ont pas prêté attention à l’essence (sout’) picturale de la question[19].“Sur l’exemple du tableau de Cézanne (Baigneuses devant la tente, 1883-1885, Staatsgalerie de Stuttgart), il déclare :
Il est visible qu’aucune figure n’est dessinée et peinte comme si elle était vivante, l’approche du paysage de même. Il n’y a aucune figuration véridique.
Il ne convient pas d’employer pour ce tableau le terme de ‘peinture’ dans le sens où on le percevait dans l’art représentateur, car les représentations y sont éloignées de la représentation vivante de la nature[20].
Là, il emploie le mot priroda, du moins dans la traduction ukrainienne (mais l’ukrainien connaît les deux appellations et il n’y a pas de raison a priori que le traducteur n’ait pas laissé les deux formes comme dans l’original).
Dans son grand texte lithographié de Vitebsk en 1919, Des nouveaux systèmes en art. Statique et vitesse, dont une version censurée a paru à Moscou en 1920 sous le titre De Cézanne au Suprématisme, le peintre met au premier plan de sa réflexion la question de la nature, qui a été comprise, depuis Aristote (évidemment, Malévitch ne le dit pas ainsi), comme objet de la mimèsis, sujette à l’imitation[21]. Continuant sans se lasser à réfuter cette interprétation, il peut déclarer devant un paysage de toute beauté :
Que voit donc le peintre dans [un tel] paysage ? Il voit le mouvement et le repos des masses picturales, il voit la composition de la nature, l’unité des formes picturales variées, il voit la symétrie et le raccordement des contradictions dans l’unité du tableau de la nature. Il reste immobile et est transporté par le courant des forces et leur entente. C’est ainsi que la nature a construit son paysage, son grand tableau multilatéral de la technique, contradictoire avec la forme de l’homme, – elle a lié les champs, les montagnes, les rivières et les mers et, grâce à la semblance humaine, elle a pulvérisé le lien entre les animaux et les insectes, elle a formé ainsi une gradation de formes sur sa surface créatrice. C’est une telle surface créatrice qui est apparue devant l’artiste-créateur : sa toile, l’endroit où son intuition construit le monde, et il règle également les forces qui passent des énergies picturalement colorées dans des formes, des lignes, des surfaces planes variées ; il fait également des formes, les éléments isolés de leurs signes, et il obtient l’unité des contradictions sur sa surface picturale. Ainsi la création de contrastes de formes formera-t-elle un accord unique du corps de l’échafaudement, sans quoi toute oeuvre créative (tvoréniyé) est impensable[22].
Et plus loin, cette affirmation capitale, anti-constructiviste par excellence :”Nous ne pouvons vaincre la nature, car l’homme est la nature. Et puis je ne veux pas vaincre, mais je veux un nouvel épanouissement[23].” Il est significatif que tous ces passages ne figurent pas dans le texte censuré, imprimé sous l’appellation De Cézanne au Suprématisme. Le peintre ukraino-russe estime que le cubisme a, dans un premier stade, réduit “la nature (natoura) à l’abstraction”, à “la simplicité géométrique des volumes”. “Le visage du modèle était peint à la fois de face et de profil, comme des juxtapositions en contraste des variétés de la forme graphique[24].” Malévitch dit à un autre moment :
On a eu à l’égard de Van Gogh la même approche anecdotique : on l’examinait aussi du côté du naturel, du non-naturel et du psychologique. Mais Van Gogh a abordé la nature (natoura) comme des plates-bandes. Outre qu’il a détourné, en les tirant des formes visibles du monde vivant, des factures purement picturales, il a vu en elles des éléments vivants en mouvement ; il a vu le mouvement et l’élan de chaque forme. La forme n’était pour lui rien d’autre qu’un outil par lequel passait la force dynamique. Il a vu que tout vibre d’un unique mouvement universel, devant lui il y avait l’acte, la victoire sur l’espace et tout s’élançait vers ses profondeurs[25].
Et dans un autre stade :
“Pour la première fois, les cubistes commencèrent à voir, à connaître et à bâtir consciemment leurs constructions sur les bases de l’unité générale de la nature (priroda). Il n’y a rien dans la nature qui soit un, tout est constitué de nombreux éléments et de nombreuses possibilités de comparaison […] L’assemblage cubiste, lui, est l’expression de la dynamique, de la statique et d’une nouvelle symétrie qui conduit à l’organisation de nouveaux signes dans la culture de la métamorphose du monde[26].
Dans sa conférence de Smolensk en 1921, il s’adresse aux élèves d’art :
Nous devons créer, et notre création sera notre croissance. Mais n’ayez crainte d’être le non-savoir, car vous êtes vous-mêmes la grande expérience de l’acte naturel selon la nature physique. C’est à travers la grande expérience de la loi naturelle selon la nature physique que nous trouvons la stabilité et introduisons notre organisme pan-humain pour l’appareillement réel du monde[27].
Le grand texte qu’est Dieu n’est pas détrôné. L’Art. L’Église. La Fabrique (1922) met la nature en tant que priroda au coeur de la question de l’homme confronté à celle-ci, cette priroda qui est devenue pour lui “un mystère” (§ 5)[28]. La pensée de l’homme, nous dit Malévitch, est pratique, figurative, alors que “la pensée de la nature est l’action simple de phénomènes sans-objet” (§ 5)[29] :
S’étant armé d’une lime, [l’homme] veut scier la nature et lui donner un nouveau sens, il veut la transformer en un état figuratif rendu intelligible, il veut la rendre intelligente, qu’elle réfléchisse sur les problèmes complexes, et elle n’a rien de tout cela, et il est impossible de la scier, car en elle, il n’y a ni d’unité ni de forme matérielle. En elle, il n’y a pas non plus de frontières[30].
Et le peintre de déclarer que “la nature est dissimulée dans l’infini et ses nombreuses facettes, et elle ne se développe pas dans les objets : dans ses manifestations, elle n’a ni langue, ni forme, elle est infinie et on ne peut l’embrasser[31].” (§7) Les efforts de l’homme pour raisonner la nature sont vains :” La raison ne peut rien dis-cerner, l’entendement ne peut rien dis-criminer, car il n’y a rien dans la nature de tel qu’on puisse dis-criminer, dis-cerner, dis-tinguer ; il n’y a pas en elle une unité qu’on puisse prendre comme un tout[32].” (§5) Et Malévitch peut faire cette profession de foi assez extraordinaire :
Le miracle de la nature est dans le fait qu’elle est tout entière dans une petite graine et cependant on ne peut pas embrasser tout cela. L’homme qui tient une graine tient l’Univers, et en même temps il ne peut la distinguer malgré toute l’évidence de l’origine de cette dernière et les “arguments scientifiques’“ Il faut discerner cette petite graine pour dévoiler aussi tout l’Univers[33]. (§7)
Il n’est pas facile de situer historialement (geschichtlich) cette pensée. Il est clair qu’elle est anti-hégélienne, car elle dénonce toute possibilité pour la raison de rendre compte du réel dans sa totalité. Elle est foncièrement antipositiviste, puisqu’elle récuse la capacité de la science de comprendre les mécanismes réels du monde. Ce n’est pas non plus un nouvel avatar du kantisme qui nie la possibilité de connaître le noumène, la chose en soi. La ligne panthéiste semblerait pouvoir être justifiée dans beaucoup de passages malévitchiens. Mais à aucun moment, chez le peintre-penseur la nature n’est associée à Dieu. De ce point de vue, il y a beaucoup de convergences avec les pensées extrême-orientales, hindoues, chinoises, japonaises, où le caractère illusoire du monde est une constante sous diverses formes ; cela est encore peu étudié et mérite d’être approfondi. Dans le cadre de notre pensée européenne, je serai enclin à penser avec Emmanuel Martineau qu’il s’agit d’une phénoménologie apophatique. Ce qui ne signifie pas pour l’auteur du livre pionnier, Malévitch et la philosophie, un refus de la manifestation :
Car si le peintre-penseur, comme la théologie orientale, maintient la prédominance de la négation à [un] plan supérieur où il s’agit de penser la suressentialité de l’être comme Rien (et non plus seulement la suressence divine), la ‘position’ reprend ses droits au niveau de l’étude des énergies de ce Rien, à laquelle est consacrée la doctrine de la ‘sensation’ et de l’ ‘excitation’[34].
Mais là, personnellement, je ne m’aventurerai pas dans un domaine qui n’est pas ma spécialité. Je laisse le soin aux philosophes de creuser la question. Je citerai encore Emmanuel Martineau : “Bien au-delà de la volonté de puissance [de Nietzsche], il y a [chez Malévitch], secrètement réservé, une autre liberté, celle de s’élancer extatiquement vers l’être, ou mieux encore vers le Rien, lui-même “libéré”[35]. Ici, il faudrait développer la négation de la volonté-vouloir chez Malévitch. Dans son article “La philosophie du kaléidoscope” dont nous allons parler,[36] Malévitch cite entre guillemets “le monde comme volonté et représentation” de Schopenhauer, dont il a pu prétendre qu’il n’avait lu que le titre à la vitrine d’un magasin, mais dont il avait, pour le moins, entendu parler plus profondément, ne serait-ce que par son ami Nikolaï Roslavets. dans le remarquable petit essai, “De l’art “sans-objet”, dont nous avons parlé plus haut, Roslavets cite Schopenhauer pour qui “seul l’intellect, libéré de la volonté, le pur intellect, est capable de s’élever jusqu’aux hauteurs de la claire vision (prozréniyé), conditionnant exclusivement la création géniale[37].” “La philosophie du kaléidoscope”[38] est un ajout à l’opus magnum du peintre, Le monde en tant que sans-objet ou le repos éternel. Il devait être inséré dans le paragraphe 41 du premier chapitre de la Seconde Partie du traité philosophique, seconde partie appelée “Le Suprématisme en tant que sans-objet”. Ce paragraphe commence ainsi : “La conscience suprématiste par rapport au monde des manifestations ou de toute la nature est l’excitation; c’est pour quoi tous les états, appelés matériaux, en fait n’existent pas[39].” Dans un article publié en 1929 en ukrainien, intitulé “L’esthétique (Essai de déterminer le côté artistique et non artistique des oeuvres”,[40] Malévitch reprend l’opposition natoura/priroda. Après avoir montré “l’absence de principe artistique” d’une “reproduction purement naturaliste de la nature”, il ajoute :
Nous sommes obligés de faire de même avec la nature (natoura). La nature ne peut jamais être artistique si l’on prend en considération le fait que tous ses phénomènes sont le produit de processus physico-chimiques, mais on peut raisonner autrement, à savoir : si la nature (priroda), dans chacune de ses modifications, ou bien si chacun de ses phénomènes, provoque une perception esthétique- artistique, alors, quelle que soit la modification physico-chimique, tout cela naît d’une seule loi esthétique et artistique de perception. Toute la nature sera alors semblable à un kaléidoscope où, en dehors de tout ordre, se bousculent des éléments colorés, où qu’ils tombent, ils resteront toujours dans des conditions telles qu’ils constitueront une forme fine et merveilleuse d’ornementation[41].
Qu’est-ce qu’un kaléidoscope?[42] Voici la définition de Malévitch :
Le kaléidoscope est un tuyau avec un miroir dans lequel sont versés plusieurs verres colorés de diverses grandeurs, se retournant toujours dans le désordre; dans notre oeil, on voit que tout s’ornementise, qu’un ordre s’établit- la ‘beauté’; les reflets se sont mis de façon égale à agir sur les circonstances environnantes, créant une forme, avalant la réalité, le chaos. Cependant, il n’y a pas de forme. Peut-être que le cerveau de l’homme est un miroir où existent seulement des reflets, tandis que la réalité reste dans son état invariable; c’est seulement lors de l’union des reflets avec la réalité que nous obtenons une loi de la forme; sans cela, il n’y a pas de forme, comme il n’y a pas d’ornement dans les miroirs du kaléidoscope quand est éloignée la réalité[43].
Ce n’est pas la première fois que Malévitch emprunte à un objet exotique du monde réel une appellation ludique pour désigner une réflexion profonde. Souvenons-nous de l’extraordinaire texte, commenté brillamment par Emanuel Martineau, “Le Poussah” : ce “magot porté par une boule lestée de telle sorte que le jouet revient toujours à la position verticale”, désigne ni plus ni moins Dieu. Et dans “La philosophie du kaléidoscope”, Malévitch reprend l’idée de Dieu n’est pas détrôné, à savoir que “dans notre culture jusqu’ici, l’homme se représente les phénomènes consistant en l’image ternaire de l’art, de la science et de la religion”[44], ces trois “voies” mènent une lutte entre elles et chacune prétend être la vérité (istina); ces trois voies sont fondées sur la foi, la foi en elles-mêmes, mais aussi sur le Futur, un Futur qui serait un commencement[45]. C’est à partir de cette réflexion, nous dit Malévitch, qu’il “a cherché une réponse dans la nature, voyant en elle l’unique coffret (lariets) dans laquelle sont assemblées des réponses; en elle gît l’image vers laquelle l’homme se fraye toutes les voies conformes au but à travers le principe de la science, de l’art et de la religion”[46]. Et de préciser que la nature n’a ni futur, ni plan sur le futur, elle est le processus du jour d’aujourd’hui et elle ne peut regarder dans le futur. Et de répéter qu’il n’y a en elle rien d’artistique que c’est dans l’homme seulement qu’existe un principe artistique :
Il n’y a dans la nature ni but, ni logique, ni de preuve, ni d’organisation, c’est seulement en moi que mes preuves scientifiques sont les formes du travail cognitif scientifique et le principe organisateur. Alors, l’être n’est pas chaos, seulement le principe organisateur de tout ce qui naît en moi; mais puisqu’il organise, moi aussi je suis organisé, car je suis seulement une particule de l’être qui n’en est pas partie et que ne le domine pas[47].
La nature est donc sans objet et la matière-nature est repos (pokoï), comme est repos le principe artistique. C’est seulement nos “hallucinations psychiques” qui nous font concevoir le mouvement et le repos[48] : “La ligne psychophysique des déformations de la vision, des hallucinations, est semblable à la cellule déformée dans le kaléidoscope par les miroirs et autre. En cette déformation consiste ce que nous appelons la nature profonde (priroda), la nature visible (natoura)”[49]. En fait, c’est “le repos qui est la fin des visions et des changements, c’est quelque chose au-delà de la conscience et de la représentation, c’est ce en quoi est la matière et ce que veut devenir également “l’âme“ “[50] .
L’homme qui crée de la beauté à partir de descriptions poétiques, picturales, musicales de la nature est en quête de l’authenticité des choses. En réalité, cette authenticité n’existe que dans nos visions fantomatiques de la nature. Et Malévitch finit par déclarer:
La nature est un certain kaléidoscope dans lequel la verroterie colorée qui y est jetée peut donner une multitude d’édifications formelles, étant elle-même dans un seul aspect invariable[51] […] Il est possible que la nature soit pour nous le même kaléidoscope en mouvement. Il est possible que notre oeil soit cette fente à travers laquelle nous voyons la nature comme une matière (viechtchestvo) invariable, tournoyante ou une cellule qui, en se reflétant dans notre oeil, provoque une multitude de phénomènes dont l’authenticité ne peut être discernable : où est l’authenticité et où est son reflet? […] Des miroirs sont tout autour et l’on ne sait pas où est l’authenticité […] et on ne peut pas casser le kaléidoscope, cela signifierait casser son cerveau, c’est-à-dire soi-même et voir que dans le cerveau il n’y a rien – nous trouverons le cerveau, mais nous n’y trouverons ni chaise, ni Dieu, ni esprit. Nous pouvons indiquer qu’à cet endroit il y avait Dieu, dans celui-là il y avait l’esprit, mais où est-ce qu’ils sont maintenant, on ne le sait pas. Dans l’esprit, dans la matière ou dans le principe artistique? Est-ce qu’est authentique mon être (souchtchestvo) physique, spirituel ou artistique, est-il beau consciemment ou inconsciemment, est-il esthétique ou, peut-être, suis-je un reflet de reflets[52]?
Et une des conclusions de cet article touffu, non rédigé, mais, comme toujours chez Malévitch, d’une efficacité barbare raffinée avec des inflexions lexicales pleines d’humour, est ainsi formulée : “La nature ne manifeste et ne révèle rien, comme cela nous semble. Les manifestations humaines restent les mêmes phénomènes du zéro invariable[53] sur lequel sont placées les espérances d’une manifestation.”
========
On le sait, Cézanne fut, prioritairement, celui qui provoqua la révolution opérée dans la création malévitchienne à partir de 1910. Or l’impulsion de Cézanne fut donnée autant sur le plan de l’approche formelle que sur le plan de la réflexion conceptuelle à partir de déclaration du Maître d’Aix. Et la nature en est le point crucial. C’est Cézanne qui emploie le premier le terme de “sensation”, si capital pour comprendre la pensée picturale de Malévitch. Cézanne parle de “la sensation forte de la nature”[54] Sans aucun doute, c’est dans la scrutation pénétrante de l’art cézannien que Malévitch a puisé sa propre conception de la nature. À propos de l’Autoportrait de Cézanne de la Collection Chtchoukine, il écrit que cette oeuvre est importante “par sa définition de la sensation picturale” : “Cet autoportrait ne coïncide pas avec la réalité. Voilà pourquoi on ne peut l’appeler un autoportrait. La forme de la nature et l’oeuvre créée sont différentes[55].” Notons ici que Cézanne avait affirmé que “l’art était une harmonie parallèle à la nature[56].” D’autre part, la réflexion sur le cubisme, surtout le cubisme de Picasso, fait comprendre qu’il ait pu penser la nature en tant que kaléidoscope. Peut-être a-t-il reçu en cela une impulsion de tel passage du célèbre article de Yakov Tugendhold dans la revue Apollon en 1914 sur la Collection Chtchoukine. Parlant du tableau de Picasso Usine (Horta de Ebro), le critique russe souligne la “combinaison de surfaces planes géométriques, pierreuses, aux facettes de miroir […] Les lignes des murs et des toits de cette Usine ne se rencontrent pas dans la direction de l’horizon, comme l’exigeait Cézanne, mais se dispersent en largeur, se sauvent dans l’infini. Ici, il n’y a pas de point mental de rencontre générale, il n’y a pas d’horizon, il n’y a pas d’optique de l’oeil humain, il n’y a pas de début, ni de fin, ici, c’est le froid et la démence de l’espace absolu. Et même les miroitements des murs de cette Usine jouent de répétitions sans nombre, se reflètent sur le ciel, font de l’Usine un labyrinthe ensorcelé de miroirs, l’hallucination d’un délire…[57]
L’obstination qu’a eue Malévitch à penser la nature s’est traduite de façon nouvelle très originale dans sa période post-suprématiste où s’opère la synthèse du sans-objet par l’énergie de la couleur et l’iconicité hiératique des contours des êtres et des choses.
[1] Hölderlin F., ” Wie wenn am Feiertage” “Elle, merveilleusement toute présente/ La puissante, la belle divinement, la Nature” (trad. Michel Deguy)
[2] Gauguin P., Racontars de rapin [1901], Paris, Falaize, ss d, p. 77
[3] Malévitch K. Dieu n’est pas détrôné. L’Art. L’Église. La Fabrique” [1922], § 7
[4] Heidegger, M., Einführung in die Metaphysik [1935] – “Die φύσις ist das Sein selbst, kraft dessen das Seiende erst beobachtbar wird und bleibt”
[5] Malévitch K., Écrits, Paris, Allia, 2015, p. 233-234.
[6] Malévitch. Colloque international tenu au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1979, p. 155
[7] Cf. Malévitch K., “Autobiographie. Extrait du manuscrit I/42”, Malévitch K., Écrits IV. La lumière et la couleur, Lausanne L’Âge d’Homme, 1981, p. 52
[8] Malévitch. Colloque international, p. 154
[9] Malévitch K. “Autobiographie. Extrait du manuscrit I/42”, op.cit., p. 51. Rappelons-nous le début du poème de Hölderlin dont un extrait est cité en exergue :
Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn |
||
Ein Landmann geht, des Morgens, wenn |
||
Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen |
||
Die ganze Zeit und fern noch tönet der Donner, |
||
In sein Gestade wieder tritt der Strom, |
||
Und frisch der Boden grünt |
||
Und von des Himmels erfreuendem Regen |
||
Der Weinstock trauft und glänzend |
||
In stiller Sonne stehn die Bäume des Haines[Comme lors des jours de fête, voir son champ/Un paysan s’en va, le matin, /Quand tout le temps de la brûlante nuit tombaient /Les éclairs rafraîchissants et qu’au loin tonne le tonnerre, /Le flot rentre sur ses bords, /Et, frais, le sol verdit/Et de la réjouissante pluie du ciel/Dégouline le cep de vigne et, étincelants, /Dans le silence solaire se dressent les arbres du taillis.] |
||