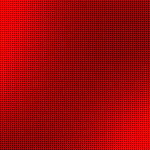Jean-Claude MARCADÉ NICOLAS DE STAËL UNE FULGURANTE QUÊTE DU VISIBLE Essai monographique/7 « Je pense pouvoir évoluer, Dieu sait comment, vers plus de clarté en peinture[1] » 1951
Jean-Claude MARCADÉ NICOLAS DE STAËL UNE FULGURANTE QUÊTE DU VISIBLE Essai monographique
7 « Je pense pouvoir évoluer, Dieu sait comment, vers plus de clarté en peinture[1] »
1951
Nicolas de Staël peint encore au début de cette année des murs aux larges parpaings tantôt horizontaux (Le Mur, Composition, coll. Gimpel and Hannover, Zurich), tantôt verticaux (Composition, ancienne coll. Jacques Dubourg, cat. n° 284). Puis il inaugure une autre iconographie murale. Ce ne sont plus désormais des pierres de taille que maçonne le peintre, ce sont des assemblages de moellons qui forment un patchwork pictural. Viennent à la mémoire ces phrases de Roland Barthes :
« Je jette ainsi sur l’œuvre écrite, sur le corps et le corpus passés, l’effleurant à peine une sorte de patch-work, une couverture rapsodique faite de carreaux cousus. Loin d’approfondir, je reste à la surface, parce qu’il s’agit cette fois-ci de “moi” (du Moi) et que la profondeur appartient aux autres[2]. »
D’une certaine manière, on pourrait appliquer ces mots à la picturalité staëlienne, sauf que les coutures des rhapsodies sont faites du mortier tout en vibrations des couleurs sans linéament. C’est à ce moment-là que l’art de Nicolas de Staël glisse de façon plus nette qu’auparavant vers une « figuration abstraite ». Que veut dire cet oxymoron ? Plus qu’auparavant, le mur devient une réalité concrète à laquelle le peintre arrache toutes les nuances qui y sont celées, les en abstrait , un peu comme Cicéron dit « a corpore animus abstractus » (l’âme détachée du corps[3]). On comprendra mieux cette formule paradoxale « figuration abstraite », si l’on examine l’extraordinaire production de dessins faits pendant l’année 1951. Staël a, depuis ses débuts, dessiné avec beaucoup de ferveur, nous en avons parlé. À partir des années 1940 et de sa non-figuration abstraite, il a créé un ensemble de dessins qui sont comme un dialogue avec la peinture. Nous nous arrêterons ici sur les dessins de l’année 1951, d’abord parce qu’ils sont scellés par la rencontre avec René Char et la fabrication d’un livre avec le poète : Poèmes de René Char. Bois de Nicolas de Staël (Paris, 1951). Il y avait quatorze bois et une lithographie en cinq couleurs en couverture. Ce projet fera l’objet d’une exposition chez Jacques Dubourg en décembre 1951, prolongeant ainsi la présentation qu’avait faite la galerie en avril-mai de la même année d’un ensemble de dessins.
Staël ne fait aucune confusion entre la discipline de la peinture et celle du dessin. Alors que la peinture évacue tout contour linéamentaire et ne fait vivre que les masses colorées, le dessin met le trait au centre de l’acte pictural. Si l’on prend le pictural comme une certaine organisation de l’espace, quel que soit le médium utilisé, le pictural est, dans ce sens, au-delà de la peinture, de la sculpture, du dessin et de toute appropriation artistique d’un lieu à organiser. Le trait fait l’objet d’autant de manipulations, de constructions, de syncopes, que la peinture.
Pour simplifier et faire mieux comprendre l’évolution de l’art staëlien en cette année 1951, on prendra un lavis d’encre de Chine sur papier, exposé à la galerie Matthiesen, à Londres en 1952 et à la galerie new-yorkaise Knoedler en 1953, intitulé Paysage pointillé. Peut-être n’est-ce pas un titre de l’artiste mais il est significatif qu’un tel titre ait pu être donné. Il correspond en tout cas à ce qui va commencer à dominer dans l’acte créateur staëlien, la présence de plus en plus insistante des éléments de la réalité sensible. Si les « murs » de 1950-1951 sont transmués en massives unités colorées, les « murs » de 1951 sont déjà des « paysages », certes totalement abstraits, au sens étymologique du terme que nous avons mentionné plus haut.
D’une certaine façon, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Staël se fait ici l’émule de Mondrian, du Mondrian qui transcrit le prétexte (arbre, mer, mur) en un système sémiotique d’équivalents du réel, ce qui aboutira aux transcriptions picturales de Londres, New York, Paris dans les années 1940. Avant de mettre en œuvre, après 1917, le « rapport primordial d’une manière précise par la dualité de position formant l’angle droit[4] », Mondrian avait « épuré » le réel par un glissement de plus en plus abstrait vers un système de signes. Notons encore que plusieurs toiles de Mondrian portent des titres non abstraits : Composition ovale (arbres) (1913, Amsterdam, Stedelijk Museum), Façade en brun et gris (1913, New York, coll. E. Kaufmann), Composition N.9 (Échafaudage) (1913-1914, MoMA), etc. À propos de sa Composition N.7 (1913, New York, Solomon R. Guggenheim), on a pu faire remarquer qu’« avec Mondrian ce sont les objets qui acquièrent la raréfaction et la luminosité atmosphériques […] Contrairement à ce qui se passe dans les désintégrations picassiennes où l’objet, si fragmenté qu’il soit, conserve toujours une présence irréductible — les objets s’amenuisent et se consument au point de s’identifier avec la lumière[5] ».
Certes, il est facile d’observer tout ce qui différencie radicalement Staël de Mondrian. Staël n’est ni cubiste, ni post-cubiste, il a en horreur les contours linéamentaires et ne pratique jamais l’angle droit. Sa nouvelle phase de 1951 peut être davantage considérée comme une déduction originale du dernier Cézanne où les œuvres « ne sont plus que vibrations aériennes, reflets et jeux de couleurs, dans lesquelles l’objet même a perdu la certitude de son contour formel et risquerait de se dissoudre dans la lumière qui le pénètre, si un ordre secret, mais effectif, ne retenait dans l’unité une composition prête à se défaire[6] ».
De plus, Mondrian a procédé par une décomposition progressive du sujet-prétexte pour en arriver à sa non-figuration abstraite qu’il a baptisée « néoplasticisme ». Staël, lui, a fait un bond dans la non-figuration, rien n’annonce ce saut dans la pure picturalité. Là gît une différence essentielle entre un héritier du cubisme parisien et, d’une certaine manière, de la réduction phénoménologique husserlienne, et un artiste héritier d’une abstraction ayant eu déjà ses lettres de noblesse et contemporain de nouvelles formes d’abstractions aussi bien que de la phénoménologie de la « perception » de Merleau-Ponty[7]. Il y a cependant des analogies entre les deux artistes. On ne s’étonnera pas que Staël ait pu recevoir quelque impulsion d’un peintre du Nord. Nous savons son engouement pour les peintres belges, flamands, hollandais dont il n’oubliera jamais dans sa mémoire plastique les leçons, les transmuant dans son prisme personnel. Ce qui, au-delà des oppositions évidentes, rapproche le peintre hollandais et le peintre russo-belgo-français, c’est, bien entendu, la thématique du mur comme prétexte à la composition picturale. Toute une série de toiles de la période cubiste de Mondrian ont comme « sujet-prétexte » les façades des maisons de Paris. Mais, chez le Hollandais, la corporalité de l’objet disparaît au profit d’un réseau de lignes et de couleurs qui tend à une plastique abstraite visant des rythmes universels au-delà de l’extériorité des choses naturelles. Nicolas de Staël, en revanche, ne se détourne pas de l’extériorité, il ne lui dénie pas de réalité. Son acte créateur s’installe au cœur même du sujet-prétexte pour en extraire, ab-straire, la peinture-lumière qui le fait vivre dans son essentialité. Différence peut-être entre le calviniste et l’orthodoxe russe…
On peut penser que l’exposition de Ravenne au musée des Monuments français, en avril-juin 1951, que Staël a vue et dont il acheta le catalogue, fut une des impulsions qui lui permit de donner une vibration, analogue à celles qui sont données par les tesselles juxtaposées de façon irrégulière dans les mosaïques, aux surfaces de ses toiles dont certaines portent des titres plus évocateurs que le simple « composition » qui coexiste : Les Toits (coll. part.), Rectangles jaunes et verts, Pavés gris (ancienne coll. Jacques Dubourg), La Ville blanche (Dijon, musée des Beaux-Arts, donation Granville),Composition en noir et blanc (ancienne coll. Jacques Dubourg), Les Feuilles mortes (Dijon, musée des Beaux-Arts, donation Granville). André Chastel a bien relevé cette association, en soulignant que l’artiste avait vu les mosaïques byzantines de Sicile déjà en 1937 : « Cette technique de gros points, unités de couleur intense, n’a rien à voir avec le “divisionnisme” au sens de Seurat et de Signac. Il ne s’agit pas d’un jeu optique, mais d’un dégagement vers le monumental[8]. » La mosaïque sert à revêtir des surfaces solides (murs et sols essentiellement) et à les faire chatoyer en couleurs lumineuses.
Encore une analogie évidente avec Mondrian : les dessins staëliens de 1951, comme, par exemple, les feutres sur papier portant le titre évocateur de Vol d’oiseau[9], et les œuvres de Mondrian comme La Mer (New York, coll. Harry Holtzmann, 1915) ou Jetée et océan (celle de la coll. Burton Tremaigne et celle du Rijksmuseum Kröller-Müller). Mondrian, comme dans ses façades et ses échafaudages, nous donne pour la mer un équivalent sémiologique de la réalité :
« Voyant la mer et le ciel et les étoiles, je les représentai par une multiplicité de croix. J’étais impressionné par la grandeur de la nature et j’essayai d’exprimer l’expansion, le repos, l’unité[10]. »
Là encore, l’analogie thématique avec Mondrian dans les dessins staëliens de 1951 s’arrête quand on compare leur picturologie, c’est-à-dire leur traitement facturel, la tissure même de la surface picturale. Chez Nicolas de Staël, il n’y a aucune rigidité des signes, aucune systématisation d’un vocabulaire hiéroglyphique ; Nicolas de Staël retrouve le trait primordial de l’écriture-peinture, celle des Chinois par exemple. Staël crée de nombreux cosmos à partir d’une saisie quasi mystique (dans le sens de l’immédiateté de cette saisie) du cosmos qui s’impose à lui.
La rencontre avec René Char et la fabrication du livre des Poèmes de ce dernier sont, on peut le dire, le véritable commencement de la Kehre dans l’œuvre de Staël. J’emploie à dessein le fameux terme heideggérien qui désigne le tournant au sein de la pensée, quand « la question de la vérité, posée en tant que fondamentale, se tourne en elle-même contre soi-même[11] ». La Kehre, ce n’est pas un virage, ce n’est pas une volte-face, ce n’est surtout pas un reniement, c’est au contraire la révélation de ce qui était enfoui dans le processus créateur antérieur et qui vient à la surface sur un mode (au sens musical) nouveau. Cela n’a pas été compris par beaucoup des contemporains obnubilés qu’ils étaient par des dogmes avant-gardistes hors desquels il n’y avait point de salut. Il y a eu un gang de l’avant-garde. C’est ainsi d’ailleurs que la peinture post-suprématiste de Malévitch a pu être considérée comme « réactionnaire ». Notion absurde, s’il en est, comme s’il y avait progrès en art ! Le seul critère est la création de formes qui s’imposent pour des raisons purement harmoniques, celles d’une résonance universelle. À René Char, Staël dit clairement ce tournant qui lui a fait découvrir des rêves anciens :
“Je ne te dirai jamais assez ce que cela m’a donné de travailler pour toi. Tu m’as fait retrouver d’emblée la passion que j’avais, enfant, pour les grands ciels, les feuilles en automne et toute la nostalgie d’un langage direct, sans précédent, que cela entraîne. J’ai ce soir mille livres uniques dans mes mains pour toi, je ne les ferai peut-être jamais mais c’est rudement bon de les avoir[12].”
La poésie de Char a fait resurgir dans le peintre la nécessité de saisir les fluctuations, les vibrations, les changements de la nature et de transcrire ces mille nuances dans un geste pictural le plus simple possible.
« On doit arriver au très simple, vite maintenant »,
écrit-il à Char au moment de la fabrication du livre[13].
Ce leitmotiv (que je vois comme mozartien) du simple pour traduire le complexe du monde est présent dans une lettre d’août 1951 à sa sœur Olga, en plein travail pour les Poèmes de Char :
« C’est l’axe qui est le plus important, la volonté, l’architecture. Il faut que tout cela monte bien, simple, coordonné. Dieu que c’est difficile la vie ! Il faut jouer toutes les notes, les jouer bien, ne pas croire à l’âme, à l’inspiration, oublier les études secondaires, détruire les encyclopédies et faire des gestes simples, bons[14]. »
Dans cette même lettre, il dit ne pas aimer la haute montagne, car « jamais rien ne bouge », ces « blocs » « inébranlables », ces « masses » sont « assommants[15] » ! Ce n’est pas sur les cimes qu’il trouvera le monde dans son infinie diversité. On ne peut être plus près d’une mystique incarnée, au plus près des choses elles-mêmes :
« J’ai besoin d’élever mes débats à une altitude unique, ne fût-ce que pour les donner en toute humilité, et cela implique beaucoup de familiarité avec ce qui se passe dans le ciel, va-et-vient des nuages, ombres, lumières, composition fantastique, toute simple, des éléments. Bien sûr toujours par rapport à moi, mais ce moi finit surtout par être mes pieds pour que l’illusion d’être une plante, ou la certitude, en soit plus immédiate [c’est moi qui souligne][16]. »
Fusion avec l’Univers !
André Chastel a vu dans les planches pour René Char « d’un noir soutenu, où se découpent des ponctuations blanches[17] », un dialogue avec le dernier Matisse, celui de la simplicité suprême des découpages et des gouaches collées[18]. Mais il y a un autre élément essentiel de la poétique de ces dessins qui a été mis en avant par René Char lui-même. C’est celui de la trace, du trait pictural comme trace, ce qui nous ramène aux origines les plus archaïques du trait du pinceau-plume. Par-delà l’hyperbole métaphorique-métonymique de Staël en yéti légendaire laissant des empreintes sur la neige (hyperbole nourrie sans doute dans l’imaginaire de Char à cause de la stature géante du peintre et de ses origines dans les neiges de la Russie), il y a là une caractéristique très profonde de l’art staëlien :
“Les empreintes pourraient être celles d’un plantigrade ou quadrumane d’une rare espèce, grand parcoureur de solitude, les bois que Nicolas de Staël a gravés pour mes poèmes (pourtant rompus aux escalades et aux sarcasmes…) apparaissent aujourd’hui pour la première fois sur un champ de galaxie et de neige que le rayon de soleil de votre regard va caresser ou tenter de faire fondre.
Staël et moi, nous ne sommes pas, hélas, des yétis ! Mais nous approchons quelquefois, plus près qu’il est permis, des vivants et des étoiles[19].”
Le travail de Staël pour ce livre n’est en aucun cas une illustration comme l’a bien souligné Guy Dumur, il s’agit plutôt d’« une sorte d’expédition géographique, la reconnaissance par deux hommes de même grandeur d’une terra incognita, maintenant visible à tous. Les bois de Staël sont exactement le relevé de cette terre et de ce ciel décrits par Char dans le Poème pulvérisé[20] ».