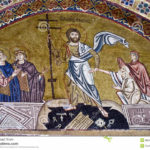Malécvitch (suite) [CHAPITRE X] Les lithographies pour livres futuristes, 1913
[CHAPITRE X]
Les lithographies pour livres futuristes, 1913
[Voir Donald Karshan, Malevich. The Graphic Work: 1913-1930. A Print Catalogue raisonné, Jérusalem, The Israel Museum, 1975 (une traduction française de la présentation a été faite à l’occasion de l’exposition de l’œuvre graphique de Malévitch au musée d’Art moderne de la Ville de Paris)].
Malévitch participe à l’aventure du livre futuriste créé par Kroutchonykh en 1912. Cet ensemble d’opuscules entièrement lithographiés, où chaque page est conçue comme une composition picturale, où le texte écrit et la calligraphie du dessin ne font qu’une entité, est une des plus grandes réussites de l’avant-garde russe.
Le grand précurseur des innovations picturo-poétique et de la réflexion sur l’origine rythmique de l’art est sans conteste Stéphane Mallarmé, dont le poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) transcrit les procédés, empruntés à la musique, de la polyphonie, du contrepoint, des leitmotive en une partition typographique. Avec Un coup de dés jamais n’abolira le hasard on a l’embryon du futur « poème-tableau » des futuristes italiens, français et russes. Marinetti, Kroutchonykh et leurs suiveurs, poètes et peintres, ne feront que développer « le rythme du livre » (lettre de Mallarmé à Verlaine du 16 novembre 1885), que le poète symboliste suggère dans sa Préface au Coup de dés : la dispersion des blancs sur la surface de la page fait naître un mouvement grâce à la « distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots ou des mots entre eux » ; cette disposition typographique qui joue des pleins et des vides, du blanc et du noir, des variétés de caractères, de la suppression de la ponctuation, a comme propriété « d’accélérer tantôt et de ralentir le mouvement, le scandant, l’intimant même selon une vision simultanée de la Page : celle-ci prise pour unité comme l’est autre part le Vers ouligne parfaite ». Même si, dans l’esprit de Mallarmé, c’était la musique qui était reconnue comme l’inspiratrice de cette révolution poétique, objectivement, la partition obtenue et son traitement ressortissent au pictural.
Dans les langues russe et ukrainienne, « peindre » et « écrire » se rendent par un seul et même verbe (pissat’/pissaty) ; cette confusion témoigne d’un état originel de l’acte représentateur quand la calligraphie était tout naturellement pictographique pour transmettre des informations ou tout simplement pour servir de rapport magique avec les forces mystérieuses du monde.
Parallèlement à la révolution typographique s’est développée une autre révolution qui unissait plus intimement le pictural et le tracé de l’écriture poétique. En avril 1910, lors de l’exposition « Le Triangle » organisée par « le grand-père du futurisme russe », le médecin-général, peintre et théoricien Nikolaï Koulbine, on est frappé par l’intérêt particulier que portent les peintres à la chose écrite. C’est ainsi qu’à côté de toiles, de gravures, de sculptures, de meubles de style, d’œuvres de l’art populaire, de dessins japonais contemporains et d’affiches françaises et hollandaises, étaient exposés dessins et autographes d’écrivains et de metteurs en scène russes. Ce n’était pas un hasard. L’exemple de Mallarmé, photographiant ses manuscrits pour composer ses Poésies complètes en 1887, avait déjà attiré «l’attention sur l’aspect visuel du vers» [N. Khardjiev, « Poésie et peinture » [1970], in N. Khardjiev et V. Trénine, La Culture poétique de Maïakovski, trad. Gérard Conio, Lausanne, L’Âge d’homme, 1982, p. 96]. L’écriture (le « manuscrit ») commençait à être prise en considération comme élément pictural. Le texte écrit à la main, souvent calligraphié, est présent sur l’icône aussi bien que sur l’image populaire xylographiée (loubok), sur les enseignes de boutiques, sur les carreaux de faïence, sur les broderies ou les rouets (œuvres auxquelles se réfèrent constamment les néoprimitivistes russes), et il a une fonction autant ornementale et compositionnelle qu’explicative. L’usage des phylactères, des légendes, des textes scripturaires peints sur le carré du Livre (la Bible, l’Évangile), coexiste avec la peinture- écriture cursive, libre, calligraphique, qui entre dans la composition d’ensemble de la surface picturale (faut-il rappeler que ces œuvres, regardées par le peuple ou destinées à son environnement, ne pouvaient être déchiffrées dans leur texte écrit que par une infime partie des utilisateurs et restent encore, pour la plupart, « privées de sens » ?).
Dans la série des livres futuristes russes de 1912-1914, il s’agit de revenir par l’écriture aux sources vives du pictural, de revivifier l’essence rythmique, tracée, gestuelle de l’écriture-peinture, de lutter contre l’invention de Gutenberg qui avait fini, par sa reproduction typographique mécanique, par tuer la vie :
“Vous avez vu les lettres de leurs mots : alignées, offensées, tondues et toutes sont pareillement incolores et grises – ce ne sont pas des lettres, mais des marques d’infamie sur le corps d’un bagnard ! Mais vous n’avez qu’à demander à n’importe lequel des langagiers, il vous dira que le mot, écrit d’une seule et même écriture ou bien composé d’un seul et même plomb, n’a rien à voir avec le même mot dans un autre graphisme.”
[Cf. V. Khlebnikov et A. Kroutchonykh, « La lettre comme telle » [1913], in L’Année 1913. Les formes esthétiques de l’œuvre d’art à la veille de la Première Guerre mondiale, sous la direction de L. Brion-Guerry, Paris, Klincksieck, 1973, t. III, p. 369]
.
La première collaboration de Malévitch à la composition d’un livre remonte à 1913, au recueil poétique de Khlebnikov, Kroutchonykh et Éléna Gouro intitulé Les Trois. La couverture est une de ses œuvres picturales les plus fortes. Ici sont associés le néoprimitivisme, le cubo-futurisme et la « transmentalité » dans l’écriture même. Les noms des auteurs sont écrits à la main dans une calligraphie cursive à peine stylisée (dans la ligne inaugurée par Larionov) ; les lettres du titre sont des capitales auxquelles le peintre fait subir un traitement cubo-futuriste (chaque lettre est construite comme un objet et disloquée en plans, ce qui met toute la composition en mouvement) ; le personnage central du paysan est lui aussi tracé en plans géométrisés, semblables à certaines esquisses de la même époque pour l’opéra La Victoire sur le soleil ; leur robustesse, leur statisme monumental sont plus expressifs encore, par contraste avec le dynamisme de l’écriture peinte ; enfin, la virgule renversée, qui détache le nom d’Éléna Gouro de celui des deux autres poètes, est typique de la transrationnalité qui, comme dans la zaoum de Khlebnikov et de Kroutchonykh, a pour fonction d’indiquer une autre logique que celle de la raison – disons, pour faire court, kantienne. Ainsi, la couverture des Trois résume en un ensemble les trois tendances qui traversent l’œuvre picturale de Malévitch entre 1912 et 1914, avant et au moment de faire le bond suprématiste dans la non-figuration absolue.
“Malévitch y a travaillé spécialement et avec insistance. Sur une photo de groupe prise dans une datcha d’Uusikirko [petit village finlandais où Éléna Gouro, la femme de Matiouchine, mourut pendant l’été 1913], Kroutchonykh tient dans ses mains l’esquisse de cette couverture qui diffère de la variante finale surtout par le dessin du titre qui n’est pas encore tout à fait trouvé.”
[E.F. Kovtoune, Litografirovannyïé izdaniya foutouristov [Les éditions lithographiées des futuristes], Moscou, Kniga, 1989, p. 60]