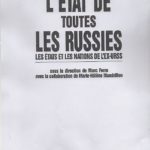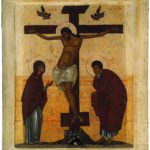Malévitch (suite) [CHAPITRE XX] Peindre et écrire
[CHAPITRE XX]
Peindre et écrire
À partir de l’apparition publique du suprématisme à Pétrograd en 1916 jusqu’à la fermeture de l’Institut national de la culture artistique (Ghinkhouk) à Léningrad en 1926, Malévitch est un des protagonistes de l’art de gauche russe. Il participe à des débats polémique avec les passéistes tel Alexandre Benois [Voir la lettre de Malévitch à Alexandre Benois de mai 1916, in Kazimir Malevich in State Russian Museum [sic], Saint-Pétersbourg, Palace Editions, 2000, p. 393]; après les révolutions de 1917, avec les constructivistes-productionnistes [Voir, entre autres, la lettre de Malévitch à la rédaction de la revue constructiviste d’architecture Sovrémiennaya arkhitektoura [L’architecture contemporaine] en 1928, in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 406-407., il anime des groupes suprématistes àPétrograd et à Moscou (1916-1918), à Vitebsk (1919-1922), à Pétrograd-Léningrad (1922-1927) ; il donne son enseignement sans relâche et crée une architecture utopique (Planites, « Architectones », etc.) [Voir Patrick Vérité, « Malevič et l’architecture. À propos des “objets-volumo-constructions suprématistes” », Cahiers du MNAM, no 65, automne 1998 , p. 39-53 ; Patrick Vérité, « Sur la mise en place du système architectural de Malevič», Revue des études slaves, Paris, LXXII/1-2, 2000, p. 191-212 ; Malévitch, peintures, dessins, cat. exp., Paris, Centre Georges-Pompidou, 1980 (textes de Jean-Hubert Martin, Jacques Ohayon, Poul Pedersen et Chantal Quirot) ; voir aussi Jean-Claude Marcadé, « Le suprématisme de K.S. Malevič ou l’art comme réalisation de la vie », Revue des études slaves, Paris, LVI, 1984, p. 61-67]. Et puis, écrit beaucoup : des pamphlets (« Les vices secrets des académiciens »[Traduit in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 70-71]), dix-huit articles dans le journal moscovite Anarchie en 1918 [Traduits in ibid.], des prises de position, des manifestes; mais, surtout, il élabore avec acharnement des textes théoriques et philosophiques dont seule une faible partie est publiée de son vivant – ces textes ne sont pas compris de ses contemporains et soulèvent même des tempêtes d’indignation chez les adversaires marxistes-léninistes du suprématisme. Malévitch est violemment attaqué par les théoriciens marxistes.
Le texte de Malévitch Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La fabrique (Vitebsk, 1922) est la dernière brochure parue du vivant du fondateur du suprématisme. C’est un des textes philosophiques les plus importants du XXe siècle. Sans aucune formation universitaire – ni même intellectuelle – suivie, par la seule pénétration de son génie, Malévitch a su développer, à partir de connaissances glanées çà et là (le Tertium Organum [1911] du théosophe Piotr Ouspienski, en particulier, a pu être une anthologie des idées venues de Grèce, d’Inde ou d’Extrême-Orient), une pensée complexe, orientée vers le questionnement de l’être en quête d’une nouvelle figure de Dieu et d’une nouvelle spiritualité. Le philosophe Emmanuel Martineau, auteur de Malévitch et la philosophie [E. Martineau, Malévitch et la philosophie, op. cit. : ce livre, à la fois « pamphlet juvénile » et profonde réflexion sur la question de l’abstraction, a pour ambition de viser à poser les premiers jalons, à partir de la pensée suprématiste de Malévitch, d’une « phénoménologie apophatique »], n’hésite pas à écrire à propos de Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La fabrique :
“Or, qu’a à dire Malévitch ? La vérité de l’être (et non point l’essence de l’étant) comme in-objectivité ; l’ineffabilité divine et la purification possible du rapport de l’homme au divin ; les conditions d’un communisme supérieur à l’humanisme du jeune Marx ; surtout : la liberté propre au Rien, d’un Rien où il faut que l’homme apprenne lui aussi à prendre son libre envol. En d’autres termes : l’affaire de la pensée suprématiste, c’est exactement ce que la phénoménologie heideggérienne portera plus tard à la parole. Et plus étonnant est qu’en résumant ainsi l’enseignement du peintre, nous n’avons rien ajouté à ses propres énoncés ; rien orné ni enjolivé : en dépit d’une formation philosophique probablement sommaire, malgré son ignorance des conditions historiques propres à l’éclosion de la méditation de Heidegger, Malévitch, faisant le plus avec le moins, trouve en dix ans de réflexion solitaire le nom propre de la question suprême : le « Rien libéré »
[E. Martineau, « Sur Le Poussah », in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 645-678, Annexes]
Le livre de Malévitch est en effet d’une richesse inouïe. Nous suivrons le philosophe français pour qui cet ouvrage se situe dans les régions de la « théologie spirituelle au sens large, patristique entre autres, incluant la théologie négative classique » et dans celles de « la théologie apo-phatique du Dieu in-objectif, présupposant, outre un accès expérimental à la vie positive du Rien, une remise en question “phénoménologique” […] de la signification de l’apophase comme telle : cette dernière parole sur Dieu culmine naturellement dans la nomination du retrait de Dieu dans Dieu n’est pas détrôné (§ 32), motif où entrent en écho imperceptible la parole de Malévitch, la parole de Hölderlin, et la parole ultime de Nietzsche » [ Ibid., p. 651]
Pour Malévitch, la mise à zéro des formes n’est qu’un tremplin pour aller au-delà du zéro, dans les régions du Rien libéré. Cet « au-delà » n’est pas une transcendance au sens traditionnel, mais est immergé dans le monde sans-objet, seule réalité.
Peinture et écriture
Il y a un passage dans la célèbre brochure lithographiée de Vitebsk Suprématisme. 34 dessins, datée par Malévitch du 15 décembre 1920, qui pose avec force la question des rapports de la pratique picturale et de l’écriture philosophique et/ou théorique chez le fondateur de l’abstraction la plus radicale qui soit née dans l’avant-garde historique européenne des années 1910-1920 :
“Le carré blanc que j’ai peint m’a donné la possibilité de l’analyser et d’avoir une brochure sur l’«action pure ».”
[K. Malévitch, Le Suprématisme, 34 dessins [1920], in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 253. Il n’y a aucune brochure sous ce nom, mais un texte, « Vers l’action pure », paru dans l’almanach de Vitebsk Ounovis no 1 en 1920 et repris, légèrement modifié, dans la revue vitebskoise L’Art,no 1, en mars : voir la traduction in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 268-273. Tous les textes qui appartiennent au cycle de l’opus magnum de Malévitch, Mir kak bespredmietnost‘ ili vietchnyi pokoï [Le monde comme sans-objet ou le repos éternel], dont la brochure de Vitebsk Bog ne skinout. Iskousstvo, Tserkov‘, Fabrika [Dieu n’est pas détrôné. L’art, l’Église, la fabrique] (1922) est une partie, sont une méditation sur l’« acte pur blanc »]
” Le carré noir a défini l’économie que j’ai introduite comme 5e mesure dans l’art.
La question économique est devenue le belvédère principal du haut duquel je considère toutes les créations du monde des choses (ce qui est mon travail principal) non plus par le pinceau mais par la plume. Il en est résulté, semble-t-il, que par le pinceau il n’est pas possible d’obtenir ce que l’on peut obtenir par la plume. Le pinceau est fouillis, et ne peut rien obtenir dans les sinuosités du cerveau, la plume est plus aiguë.”
[ K. Malévitch, Supématisme, 34 dessins [1920], in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 253]
À la fin de ce petit texte, il déclare :
“Je me suis retiré dans le domaine, nouveau pour moi, de la pensée et, dans la mesure de mes possibilités, je vais exposer ce que j’apercevrai dans l’espace infini du crâne humain.”
Premier commentaire
Malévitch donne un ordre chronologique et logique à la théorie : celle-ci vient après l’œuvre créée. Certes, quand il crée, l’artiste ne cesse pas de penser : l’acte de penser et l’acte de faire sont indissociables dans l’art suprématiste. Pour autant, la peinture suprématiste n’est pas une peinture philosophique, ce qui la situerait encore dans l’illusionnisme, elle est une peinture en action philosophique. Malévitch écrit :
“Ce système dur, froid, sans sourire, est mis en mouvement par la pensée philosophique .”
[Kazimir Malévitch, « Le suprématisme » [1919], in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 193]
Ou bien :
“Le suprématisme possède dans un de ses stades un mouvement purement philosophique, un mouvement de cognition à travers la couleur.”
[ Ibid.]
Cela signifie que le pictural et le philosophique (le noétique) se fondent en un seul acte, acte qui rend manifeste le monde comme étant sans-objet (mir kak bespredmietnost’).
Quand il s’aventure dans les « régions de la pensée » et qu’il écrit, Malévitch dissocie ces deux stades indivisibles du travail créateur : il se penche sur l’acte du cerveau créateur, sur l’acte noétique qui traverse ce qui a été créé intuitivement. L’auteur du Quadrangle noir de 1915 est clair à ce sujet :
“Le stade suprématiste comme nouvelle circonstance m’a montré que dans son prisme se sont produits trois stades, un coloré et deux stades de distinctions du sans-couleur, du noir et du blanc, selon les formes des trois carrés. Cela a été accompli instinctivement [stikhiïno] en dehors des argumentations de leurs significations que j’essaie d’éclaircir aujourd’hui. J’ai vérifié […] ma ligne suprématiste et la ligne de la vie en général, en tant qu’énergie, et j’ai trouvé leur identité avec le graphisme sur le mouvement de la couleur. Trois stades ont été élucidés dans le suprématisme : du coloré, du noir et du blanc, ce qui m’a donné la possibilité de construire un graphique et d’élucider l’avenir dans le carré blanc, en tant que nouvelle époque blanche de la construction du monde du suprématisme sans-objet.”
[ Kazimir Malévitch, « K II Tchasti Souprématizm kak bespredmietnost’, absoliout, otdyx » [Pour la IIe partie du suprématisme comme sans-objet, absolu, repos (début aznnées 1920), carnet manuscrit, archives privées, Saint-Pétersbourg, p. 43]
Le caractère spontané, instinctif, inattendu même de l’apparition du Quadrangle a été souligné par la peintre Anna Léporskaya, qui a été très proche de Malévitch de la seconde moitié des années 1920 jusqu’à sa mort en 1935. Elle rapporte que le peintre « ne savait pas et ne comprenait pas ce que contenait le carré noir. Il le considérait comme un événement si important dans sa création que pendant toute une semaine, selon ses propres dires, il n’a pu ni boire, ni manger, ni dormir » [Anna Leporskaïa, « Anfang und Ende der figurativen Malerei und der Suprematismus »/« The Beginning and the End of Figurative Painting – Suprematismus », in Kasimir Malewitsch. Zum 100. Geburtstag, op. cit., p. 65].
Second commentaire
À propos du « pinceau » et de la « plume », Malévitch nous dit que le premier est « fouillis », ébouriffé, et ne peut rien obtenir « dans les sinuosités du cerveau » et la seconde, « plus aiguë » : le peintre, en disant que la plume qui écrit et transcrit la pensée va au plus profond de l’authenticité du monde, nous dit par là que pinceau et plume sont en quête de la même chose, du monde vivant authentique, des rythmes de l’excitation universelle, du monde sans-objet, du Dieu non figuratif. Écrit et art, plume et pinceau disent donc le même. Ils ont des sites identiques sinon semblables. L’écrit et l’art, puisqu’ils se complètent dans leur quête du même, disant la mêmeté par des voies différentes, sont, dans le meilleur des cas, dans les cas privilégiés, en état de dialogue, de colloque, d’explication, comme on dit : « on va s’expliquer », – ce que l’allemand nomme l’Auseinandersetzung.
Le fait d’écrire est donc pour Malévitch une nécessité pour comprendre sa propre création. Deux aspects coexistent dans ses textes : le déroulement d’une pensée sur l’être, sur ce qui est, donc une ontologie ; et une explication, selon cette ontologie, du suprématisme comme aboutissement d’un processus pictural ayant commencé avec Cézanne. Les écrits de Malévitch nous livrent ainsi à la fois une philosophie originale que plusieurs exégètes, en particulier le philosophe français Emmanuel Martineau [E. Martineau, Malévitch et la philosophie, op. cit.], ont pu situer dans l’histoire de la philosophie occidentale, et un exposé du suprématisme dans ses différents stades et dans sa signification.
Le cas de Malévitch est unique dans l’histoire de l’art car nous avons affaire à un grand peintre et à un grand penseur. Beaucoup de peintres, de Léonard de Vinci à Kandinsky, ont laissé des réflexions philosophiques, mais Malévitch a créé un système ontologique, une réflexion sur l’étant (das Seiende, qui chez lui peut s’appeler yavléniyé [phénomène], obstoïatel’stva [circonstances], otlitchiya [distinctions], razlitchiya [différences]) et sur l’être [das Sein – bytiyé].
Il y a toujours eu une méfiance de la part des « philosophes professionnels » à l’égard des peintres qui écrivent. Un grand esprit a résumé ce pessimisme, c’est le philosophe médiéviste Étienne Gilson ; il semble donner raison à ceux qui reprochaient à Emmanuel Martineau ou à moi-même, il y a quelques années déjà, d’oublier que Malévitch était un peintre quand nous nous plongions dans ses écrits :
 “Être peintre n’interdit pas à l’artiste d’être aussi écrivain, mais il ne saurait pratiquer les deux à la fois. Les vrais peintres savent bien qu’il leur faut choisir entre peindre, écrire ou parler.”
“Être peintre n’interdit pas à l’artiste d’être aussi écrivain, mais il ne saurait pratiquer les deux à la fois. Les vrais peintres savent bien qu’il leur faut choisir entre peindre, écrire ou parler.”
[Étienne Gilson, Peinture et réalité, Paris, Vrin, 1972, p. 290. Notons que Malévitch, au moment où il s’éloigne dans « les régions de la pensée », entre 1920 et 1924, cesse pratiquement de peindre]
Et encore :
“Quand ils écrivent ou parlent de leur art, les peintres éprouvent autant de difficulté que les autres hommes à s’exprimer sur un sujet dont l’essence est étrangère au langage. Ils ont l’immense supériorité de savoir de quoi ils tentent de parler, mais même dans les cas les plus favorables, Constable, Delacroix ou Fromentin par exemple, un peintre qui écrit est un écrivain, non un peintre. Les cas les moins favorables sont ceux où, au lieu de parler d’expérience, le peintre se met à philosopher. Il n’est alors, le plus souvent, que l’écho de notions philosophiques devenue banales, dans le cadre desquelles il s’efforce de faire tenir son expérience personnelle au lieu de réformer ces notions pour les lui adapter.”
[ Ibid., p. 298.
Malévitch fait mentir cette remarque de Gilson. Emmanuel Martineau, un élève spirituel de Gilson, a repris la question « écrit et art » là où le premier l’avait abandonnée. Il pose le problème des relations entre l’ontologie malévitchienne et la phénoménologie. Martineau ne dit pas « Malévitch-philosophe » ou « la philosophie de Malévitch », il dit : « Malévitch et la philosophie », c’est-à-dire un dialogue du peintre écrivant avec toute une tradition de la philosophie depuis ses origines qu’il a retrouvée « dans les sinuosités du cerveau », sans avoir la moindre formation philosophique qui l’y préparât. Martineau, qui n’avait en 1977 à sa disposition qu’une partie du Nachlass [En particulier en allemand : le célèbre Cahier du Bauhaus de 1927, Die gegenstandslose Welt (traduit par Alexander von Riesen), et la traduction par Hans von Riesen en 1962 sous le titre Suprematismus. Die gegenstand slose Welt (présenté par Werner Haftmann). Malgré le mérite de ces traductions allemandes, les Riesen se sont permis des arrangements, voire des coupures d’ordre idéologique, trouvant, selon toute vraisemblance, plusieurs formulations malévitchiennes ni politiquement ni philosophiquement correctes. Une version allemande de plusieurs textes de Malévitch a récemment été publiée par Aage Hansen-Löve : Kazimir Malevič, Gott ist nicht gestürzt ! Schriften zu Kunst, Kirche, Fabrik, op. cit.], affirme :
“L’œuvre intégrale de Malévitch – l’écrit et le peint – possède cette propriété unique que, pour la première fois depuis que les peintres sont entrés en rapport avec la littérature, l’écrit y est d’une égale importance strictement égale à celle du peint – au point même que l’autonomie de celui-ci, sans devoir naturellement être révoquée en doute, devient essentiellement digne de question.”
[E. Martineau, Malévitch et la philosophie, op. cit., p. 78]
Malévitch écrit-il mal ?
.
La langue de l’auteur de Dieu n’est pas détrôné a pu paraître à la plupart de ses contemporains comme embrouillée, fautive, voire sans queue ni tête, à la limite de l’intelligibilité. Souvenons-nous qu’Alexandre Benois, critique patenté du « Monde de l’art », a traité de « torchon » [bumažonka] le tract de Malévitch, distribué (avec les tracts de Pougny, de Ksana Bogouslavskaïa, de Mienkov et de Klioune) à la « Dernière exposition futuriste de tableaux, 0,10 » qui s’est tenue à Pétrograd à la toute fin de 1915, et a assimilé les artistes de cette manifestation, Malévitch en tête, aux démons de Gadara dans l’Évangile selon Saint Matthieu (Matt.8, 28-34), en leur conseillant «d’aller s’installer dans un troupeau de porcs et de disparaître dans l’abîme marin 432 » ![A. Benois, « Posliedniaïa foutouristitcheskaïa vystavka » [La dernière exposition futuriste], Rietch‘, 9, [21] janvier 1916, p. 3, extraits traduits in Kazimir Malévitch, Écrits (Annexes), p. 614-615]
La même violence se manifesta six ans plus tard après la parution à Vitebsk, en 1922, de Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La Fabrique : le critique communiste, champion de l’« art productiviste », Boris Arvatov vilipende la langue absconse du traité de Malévitch, langue « qui se présente comme on ne sait quel mélange ventriloque de pathologie et de maniaquerie de dégénéré [vyrojdientsa], s’imaginant être un prophète 433 » [Dans la revue Petchat‘ i révolioutsiya, 1922, fasc. 7, p. 343-344]. Quant au critique marxiste Sergueï Issakov, qui, entre autres, fut en 1915 un défenseur des contre-reliefs de Tatline, il dénonce la «philosophie avortée de l’Absolu » qui se dégage de la « brochure abracadabrante Dieu n’est pas détrôné ». [Sergueï Issakov, « Tserkov‘ i khoudojnik » [L’Église et l’artiste], Jizn‘ iskousstva, 10 avril 1923, no 14, p. 20 ; voir traduction française in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 638-642. C’est à cet article que répond Malévitch dans « Van’ka-vstan’ka » [Le poussah], Jizn‘ iskousstva, 29 mai 1923, no 21, traduit in ibid., p. 360-363]
Il serait possible de multiplier les citations qui relèvent tout simplement le caractère non normatif de la langue utilisée par Malévitch, et parfois s’en indignent violemment, la rejetant comme un amas de phrases creuses. Souvent, les traductions les « arrangent », les« aplanissent ». Les raisons en sont multiples : soit les traducteurs ont eu peur de se voir reprocher de ne pas bien faire leur travail, soit ils ont désiré rendre plus intelligible la pensée de l’auteur. Le cas le plus flagrant est la traduction allemande des manuscrits, dont nous avons déjà répété que, tout en respectant globalement l’esprit de la pensée malévitchienne, elle donne à celle-ci des accents langagiers plus proches de la Naturphilosophie allemande que de la rhétorique futuriste. L’accès à Malévitch n’est donc pas aisé, et beaucoup, qui renoncent à approfondir les textes et restent sur une impression de chaos et de magma, nient toute valeur au suprématisme philosophique pour ne retenir que le génie incontestable du peintre. D’autres encore se contentent de relever le caractère soi-disant astructurel et contradictoire de la pensée de l’auteur du Monde comme étant sans-objet ou le Repos éternel.
« Dommage que je ne sois pas écrivain », écrit Malévitch à la femme du critique littéraire et philosophe Guerchenzon [Lettre de Malévitch à Mme Maria Guerchenzon du 28 février 1919, in Malévitch, Œuvres en cinq volumes, t. III, p. 375 ] ; en fait, l’écrivain dont il parle, c’est un homme de lettres dont le métier est d’écrire. Et il est vrai que dans le style de Malévitch l’anacoluthe est chose fréquente et la syntaxe est malmenée ; et pourtant, quand on lit cette même lettre, on découvre le talent narratif, la force des images, l’humour de son auteur, ce qui force à penser que cet aveu de ne pas être écrivain est une prétérition.
Au critique littéraire N.I. Khardjiev, Malévitch a déclaré :
“Je n’aime pas refaire et répéter ce qui est déjà écrit. Cela m’assomme ! J’écris autre chose. Mais j’écris mal. Je n’arriverai jamais à apprendre…”
[ N.I. Khardjiev, « Vmiesto prédisloviya » [En guise de préface], in K istorii rousskogo avangarda [The Russian Avant-Garde], Stockholm, 1976, p. 101, en français in Malévitch. Colloque international…, p. 151]
Le commentaire de ces propos mérite d’être cité pour sa justesse :
“L’énergétisme de son « style pesant » était apprécié par peu de personnes. Même un des disciples les plus proches de Malévitch, El Lissitzky, qui a traduit ses articles en allemand, considérait que chez lui « la grammaire est sens dessus dessous ». Et pourtant, Malévitch possédait l’admirable capacité de fixer les processus de la pensée vivante. Il écrivait avec une rapidité extraordinaire et presque sans ratures.”
[Ibid.]
Notons l’expression « l’admirable capacité de fixer les processus de la pensée vivante », car là est dite la qualité fondamentale de l’écriture malévitchienne qui, comme celle du poète, est soulevée par «la tempête du rythme» «pur» et «nu»[ K. Malévitch, « Sur la poésie » [1919], in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 181], qui est animée par les mêmes mouvements impétueux que ceux du peintre dont « le cerveau brûle » et embrase les couleurs « revêtues des teintes de la nature » . [ Ibid.]
L’image du feu est une constante de la pensée malévitchienne.
“L’excitation [i.e. l’esprit de la sensation du sans-objet] est une flamme cosmique qui vit du sans-objet]”
[K. Malévitch, Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La fabrique, in Kazimir Malévitch, Écrits, p. 312, § 5]
Ou bien encore :
“L’excitation comme cuivre fondu dans un haut-fourneau bouillonne dans un état purement sans-objet. […] L’excitation-combustion est la force blanche suprême qui met en branle la pensée. […] L’excitation est comme la flamme d’un volcan qui trépide à l’intérieur de l’homme sans visée de sens. […] L’homme est comme un volcan d’excitation tandis que la pensée se préoccupe des perfections.”
[.K. Malévitch, Souprématizm. Mir kak bespredmietnost’ ili vietchnyi pokoï [Le suprématisme. Le monde comme étant sans-objet ou le repos éternel], in Malévitch, Œuvres en cinq volumes, t. III, p. 219-220 (traduit en français par Gérard Conio : Kazimir Malévitch, Le Suprématisme : le Monde sans-objet ou le Repos éternel, op. cit.). Sur l’excitation comme primum movens et sur l’influence de Mikhaïl Guerchenzon pour la question des « perfections », je renvoie à mon avant-propos et à ma préface, « Une esthétique de l’abîme », op. cit., p. 7 ; version anglaise : « An Approach to the Writings of Malevich », art. cité, p. 225 sq. ; voir aussi ma « Postface » de Kazimir Malévitch, Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église, La fabrique, op. cit., p. 87-94]
Mentionnons encore ce passage très nietzschéen :
“Marinetti et moi, nous avons passé nos années d’enfance et de jeunesse sur les hauteurs de l’Etna ; nos seuls interlocuteurs furent des diables qui apparaissaient à travers le conduit de fumée de l’Etna. Nous étions alors des mystiques, mais les diables nous tentaient tout le temps avec la science matérialiste et prouvaient que l’art doit être aussi matérialiste. J’étais, il est vrai, un peu dur à la détente, mais Marinetti, lui, fit sienne cette idée et pondit un manifeste qui chantait les conduits de cheminée des usines et toute leur production .”
[ Cité par Evguénii Kovtoune comme épigraphe de son article « “Les mots en liberté’ de Marinetti et la “transmentalité” (zaoum’) des futuristes russes », art. cité, p. 234]
Il est intéressant de noter à ce propos que le fondateur du suprématisme place, comme étant les deux piliers, les deux « prismes », du nouvel art du XXe siècle, Picasso et Marinetti [Malévitch défendra Marinetti contre les détracteurs russes de celui-ci dans les années 1910 comme dans les années révolutionnaires 1920 ; voir Jean-Claude Marcadé, « Marinetti et Malévitch », in Présence de Marinetti, op. cit., p. 256-257]. L’influence de Marinetti est irréfutable dans le style et l’expression malévitchiens où l’on trouve les accents, les tournures et le lexique du poète italien. Malévitch adopte la rhétorique exclamative futuriste de Marinetti, son aspect parfois pamphlétaire, sa manière aphoristique, chaque proposition martelant le discours comme un mot d’ordre, un slogan.[Les principaux écrits de Marinetti et des futuristes italiens furent publiés en russe principalement en 1913-1914 ; voir Cesare G. De Michelis, Il futurismo italiano in Russia. 1909- 1929, Bari, De Donato, p. 269]
L’influence marinettienne s’est conjuguée chez Malévitch avec celle de la poétique transmentale [zaoum’] russe, celle en particulier de Khlebnikov et de Kroutchonykh dont il a été toujours très proche [Cf. Dora Vallier, « Malévitch et le modèle linguistique », art. cité, p. 284-296 ; R. Crone, « Zum Suprematismus. Kazimir Malevič, Velimir Chlebnikov und Nikolai Lobačevskij », art. cité, ; du même, « À propos de la signification de la Gegenstandslosigkeit chez Malévitch et son rapport à la théorie poétique de Khlebnikov », in Malévitch. Cahier I, p. 45-75, et aussi Kazimir Malevich. The Climax of disclosure, Munich, Prestel, 1991, p. 89 sqq.. Ajoutons à cela les substrats linguistiques de son expression littéraire, ceux du polonais et surtout de l’ukrainien, mis souvent au service d’une esthétique hyperbolique et baroque]
Marinetti n’a pas marqué l’auteur de Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La fabrique seulement sur le plan stylistico-formel, dans le souffle même qui parcourt la prose du peintre, il l’a marqué aussi dans le domaine des idées : l’anti-académisme ; l’anti-hédonisme; l’anti-humanisme; la polémologie; partiellement, l’économie; le blanc (héritage mallarméen chez Marinetti) ; l’intuition opposée à la raison ; la « splendeur géométrique et mécanique ». Mais, de toute évidence, Malévitch intègre ces emprunts, conscients ou inconscients, dans une philosophie totalement nouvelle, éclairée par une perspective ontologique.[Sur ce sujet des convergences et des divergences des pensées de Marinetti et de Malévitch, je me permets de renvoyer à mon article cité plus haut « Marinetti et Malévitch », p. 250-265]
Je ne reviendrai pas ici sur ce que j’ai développé ailleurs concernant l’importance pour la formation intellectuelle de Malévitch des différentes idées éparses et diffuses qui constituent le Zeitgeist du début du XXe siècle avant la Première Guerre mondiale : le socialisme religieux, les chercheurs et les constructeurs de Dieu, l’empiriocriticism d’Avenarius et de Mach [Cf. Jean-Claude Marcadé, « Une esthétique de l’abîme », op. cit., et « An Approach to the Writings of Malevich », art. cité]. Une place spéciale doit être faite au Tertium Organum du théosophe Ouspienski (1911), lu par toute l’avant-garde russe, qui révèle des parentés lexicales et de pensée avec les textes de Malévitch, même si ce dernier a ironisé sur les recherches du « nouvel homme », en particulier tournées vers l’Inde, qui « finissent toutes par un bon nettoyage de l’estomac » [K. Malévitch, Lettre à Alexandre Benois de mai 1916, in Kazimir Malevich in State Russian Museum [sic], op. cit.. D’autre part, le Tertium Organum est une anthologie philosophique qui présente et cite un nombre important d’extraits tirés de la philosophie universelle. Je ne reviens pas sur l’importance, que j’ai soulignée ailleurs [.Voir ma « Postface » de Kazimir Malévitch, Dieu n’est pas détrôné. L’art. L’Église. La fabrique, op. cit. ] du dialogue que Malévitch a entretenu avec le critique littéraire et penseur Mikhaïl Guerchenzon, qui l’a encouragé à écrire, et sur la portée qu’a eue pour sa réflexion le livre de ce dernier L’Image ternaire de la perfection (Troïstviennyi obraz soverchenstva) [1918] [La correspondance de Malévitch avec Mikhaïl Guerchenzon entre 1918 et 1924 a été publiée dans Malévitch, Œuvres en cinq volumes, t. III, p. 327-353]
Cependant, comme l’a souligné avec raison Emmanuel Martineau, toutes ces Weltanschauungen religieuses, politiques, cosmogoniques ou autres, permettent seulement de « mieux mettre en évidence, par contraste, chez le seul Malévitch, le travail secret de la question de l’être » [E. Martineau, Malévitch et la philosophie, op.cit., p. 102]
Nous avons déjà noté la proximité avec un certain nietzschéisme. On pourrait multiplier les références, mais, comme le souligne de son côté l’historien de l’art tchèque disparu Jiři Padrta, Malévitch est parvenu à transformer «tous ces acquis en l’indomptable flamme de sa vision du monde sans-objet, qui se communique dans le rayonnement de son art non figuratif. Une chose est certaine : il ne s’agit nullement d’une compilation plus ou moins originale de plusieurs systèmes d’emprunt, ni d’une somme imposante du fonds commun des idées que l’on trouve par intermittence depuis l’Antiquité jusqu’au siècle des Lumières ; encore moins de leur simple reproduction, qu’on veuille la considérer fidèle ou qu’on lui concède le droit à une déformation dite de génie (tout est permis à une pensée sauvage !) – il y va, après tout, d’une édification minutieusement réfléchie et en même temps constamment agitée de secousses, d’une “Tour de Babel” qui monte jusqu’au sans-objet, dont l’auteur est l’enjeu 453 » [J. Padrta, « Le monde en tant que sans-objet ou le repos éternel. Essai sur la précarité d’un projet humaniste », in Malévitch. Cahier I, p. 176-177].
.
Réception et enjeu de la pensée suprématiste